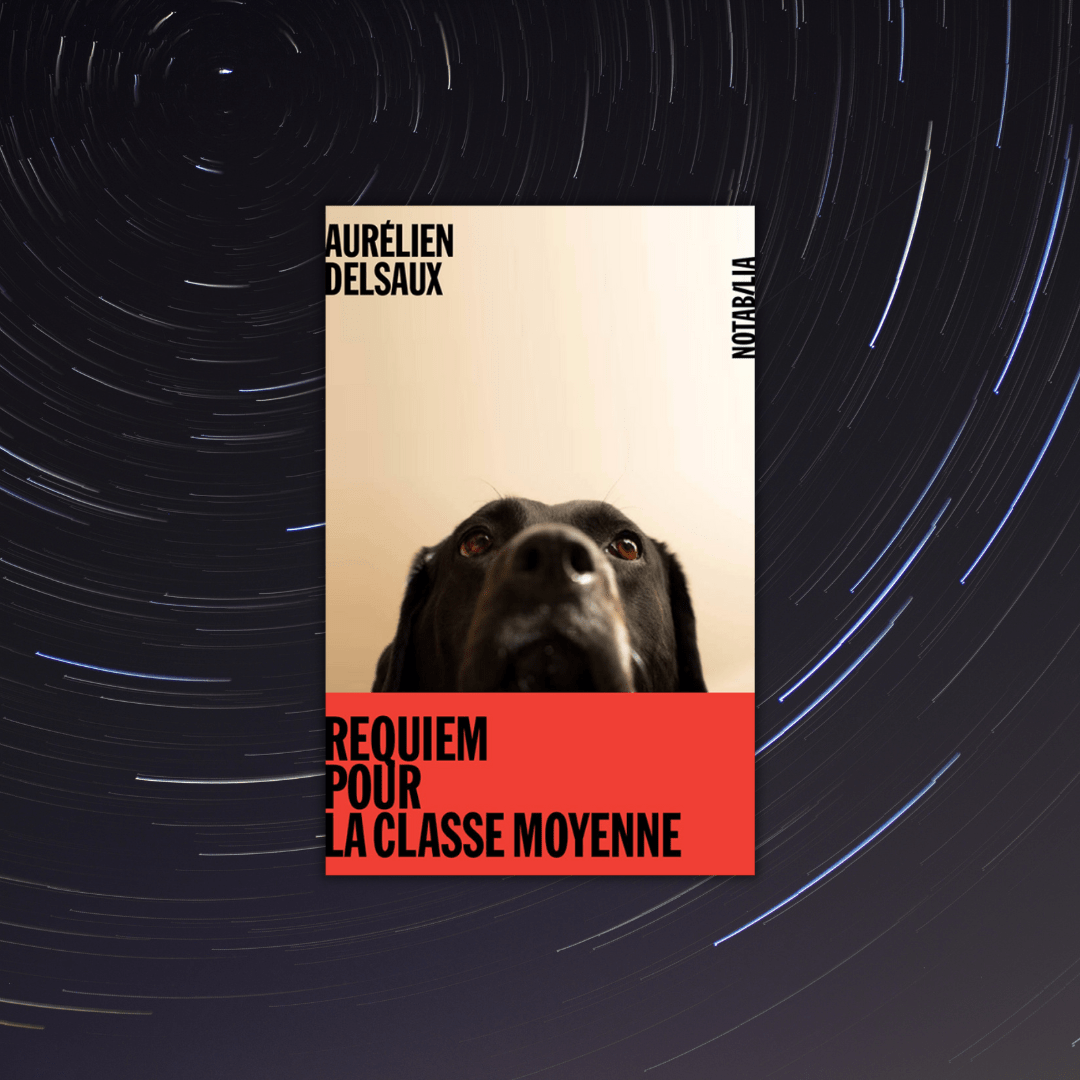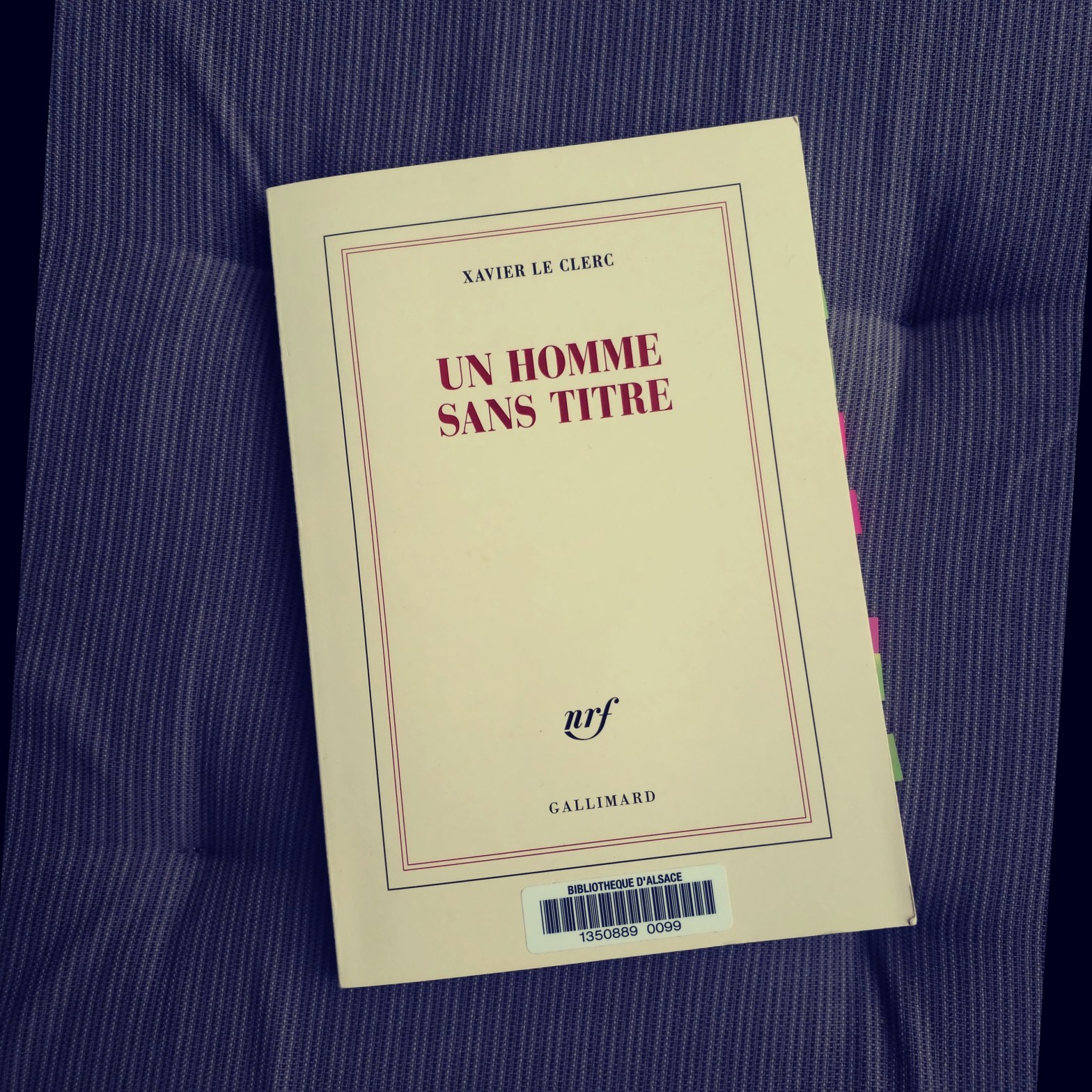Une fois commencé, impossible de lâcher ce roman. Erwan nous raconte sa vie, son travail à l’abattoir d’Angers et surtout nous tient en haleine jusqu’au bout pour savoir pourquoi il se trouve en prison. Ce qu’il appelle « l’événement » ne sera révélé qu’à la toute fin du livre.
L’écriture de Timothée Demeillers est puissante et rythmée. Il arrive à faire ressentir les odeurs, les bruits de l’usine et le sang. La cadence également, avec les « clacs » de la chaîne qui reviennent régulièrement dans le texte. Erwan est affecté au poste des frigos. Il tri les demi-carcasses de viandes qui arrivent par la chaîne. Et on lui demande d’en trier de plus en plus. La cadence augmente encore et toujours. Le maître mot est la rentabilité.
C’est un roman notamment sur la condition sociale, le mépris d’une classe pour une autre, les cols blancs vis-à-vis des ouvriers. La déshumanisation et les nouvelles techniques managériales sont pointées. La pénibilité du travail et les corps usés sont aussi au cœur de ce roman. Et cela résonne tout particulièrement en cette période où l’augmentation de l’âge du départ à la retraite est au cœur des débats.
On ressent un milieu assez dur, très masculin et macho, avec des blagues poussives. Erwan est lassé de tout cela. Il est en souffrance. Sa famille est une bouffée d’air, tout comme sa rencontre avec Laetitia, une saisonnière.
Timothée Demeillers s’est inspiré de son expérience personnelle. Il a travaillé pendant 4 mois dans un abattoir, en été, lorsqu’il était étudiant. Il a rencontré les personnages que l’on croise dans le livre.
On pense forcément à Joseph Ponthus et son roman « A la ligne » où le narrateur est aussi un ouvrier mais dans une usine de poissons, un abattoir de Bretagne.
Vous aurez peut-être envie d’arrêter ou de réduire votre consommation de viande après cette lecture. Mais Timothée Demeillers ne porte aucun jugement. Ce n’est pas un livre militant. En tout cas on en apprend beaucoup sur le métier et le milieu des abattoirs, tout en réfléchissant à notre rapport à l’animal.
A la fin du livre, vous trouverez une playlist pour rester dans l’ambiance du roman.
Il a été multi-sélectionné pour des prix. L’auteur a d’ailleurs eu le prix Hors Concours en 2021 pour son roman « Demain la brume ».
« Jusqu’à la bête » vient de sortir dans la toute nouvelle collection poche d’Asphalte, l’occasion de se faire plaisir à petit prix et de plonger dans une atmosphère particulière ! Foncez chez votre libraire et ne manquez surtout pas cette pépite !
Quant à moi, j’ai hâte de lire son prochain roman qui aura pour thème les Sudètes.
Je vous recommande bien évidemment le replay et le podcast de la rencontre VLEEL.
Incipit :
« Tout est plus difficile aujourd’hui, c’est sûr, enfermé à double tour dans cette geôle de béton et de barbelés, à entendre les cris, à entendre les claquements des lourdes portes métalliques, à entendre tout ce vacarme, comme un rappel de l’usine, des hurlements des scies sauteuses, des clacs, les clacs de la chaîne, si distants mais si familiers, à ressasser ce qui m’a amené ici, ce qui m’a fait plonger dans ce cauchemar alors que rien ne m’y prédestinait, ou peut-être tout au contraire, à passer des journées avec les souvenirs pour compagnons, comme du temps des frigos, comme du temps où tout a commencé, comme du temps où je devais déjà accompagner mon silence, mon ennui, ma peine de belles histoires pour nourrir le vide. »
« Clac, clac, clac, chante le chaîne.
Clac, clac, clac, chantent les dents des ouvriers frigorifiés.
Clac, clac, clac, résonne la faux que tapote la mort avec désinvolture, et c’est elle qui nous attend au coin, à l’arrêt suivant, à l’horizon de nos vies, qui n’auront pas rimé à grand-chose. »
« Il me hèle de loin. Alors le planton des frigos. Pas trop chaud à l’extérieur ? Je m’arrête et m’approche. Quoi, je lui dis, qu’est-ce qu’il y a ? Je voudrais qu’il me le répète en face. Mais il se tait, il me dévisage agacé et me demande ce que je fabrique là, si j’ai besoin de quelque chose, si j’ai une réclamation à faire. En compagnie des autres commerciaux et de jeunes stagiaires. Que dissimulent leurs rires, détournent les yeux, cachent leurs bouches de peur de révéler des rictus incontrôlables. Et moi qui les fixe bêtement, la démarche hésitante, sans savoir quoi répondre. Et moi qui repars vers ma voiture et les rires peuvent enfin exploser. Salut, le planton des frigos, j’entends dans mon dos. Salut, ducon. »
« Le directeur commercial export vient dans mes frigos inspecter sa marchandise, son bétail mort. Le directeur commercial export. Il me serre la main, molle, froide, mécanique. Je lui rends sa poignée de main et je baisse les yeux. Salut, ducon. Il vient parader dans mon domaine. Dans mon frigo dont il prend soudain possession. Il me dit ce serait bien que tu évites de mettre les Van Eck et les Charolux ensemble. Oui. D’accord. Ça m’était sorti tout seul de la bouche. Oui. D’accord, je lui avais répondu. Et je m’étais exécuté, bien sûr. Je m’étais tu. J’avais écouté ses réprimandes. J’avais obéi. Et je lui avais de nouveau serré la main. Froide et mécanique. Comme mon environnement. Froid et métallique. De la tôle. Des générateurs. Des rails bruyants. Des lames de scie qui crient leur peine. Qui rugissent au contact des os des bêtes. Qui résonnent entre les parois. Dans nos têtes. Des lames. Des crochets. Tout est fait pour faire mal. Pour blesser. Pour tuer. Du bruit. On peut tuer avec le bruit, aussi. On peut tuer avec ses mains, aussi. Avec cette main que je viens de serrer. Qu’il essuie discrètement sur son tablier. Et le directeur commercial export repart vers ses jeunes bovins d’à peine vingt mois qui n’auront jamais vu le jour, aux muscles gonflés artificiellement par le gavage en élevage, ou vers ses vaches rachitiques. Vieilles et usées. Tirées pendant des années pour du lait. Génitrices de veaux à la pelle. De dizaines de veaux. Âgées de dix ans et plus bonnes à rien. Juste à l’abattoir, maintenant. »
« Moi, j’en connaissais des types avec qui je bossais, du jour au lendemain, qui se sont retrouvés agents de maîtrise. On sait que c’est la fin d’une période. Qu’on ne pourra plus jamais partager nos déjeuners. Beaucoup ne tiennent pas. Ils demandent à la direction de les remettre sur la chaîne. De retourner à leurs postes d’avant. Mais ce ne sera jamais plus pareil non plus. On a trahi. On a voulu trahir. On a voulu s’élever de sa condition d’ouvrier, prendre le dessus sur les collègues et toute la chaîne de production s’en souviendra. Les patrons aussi, d’ailleurs. Parce qu’on n’a pas eu assez de cran. »
« Mais il me suffisait d’un bruit, d’un mot, d’une odeur pour tout faire ressurgir, comme si l’usine n’était toujours qu’enfouie, qu’assoupie et pouvait se ranimer d’un moment à l’autre, une côte de bœuf saignante au restaurant, le bruit des vagues qui soudain rappelait le générateur, la tôle des entrepôts dans les zones industrielles, et c’était parti pour de longues heures peuplées de fantômes de carcasses. »