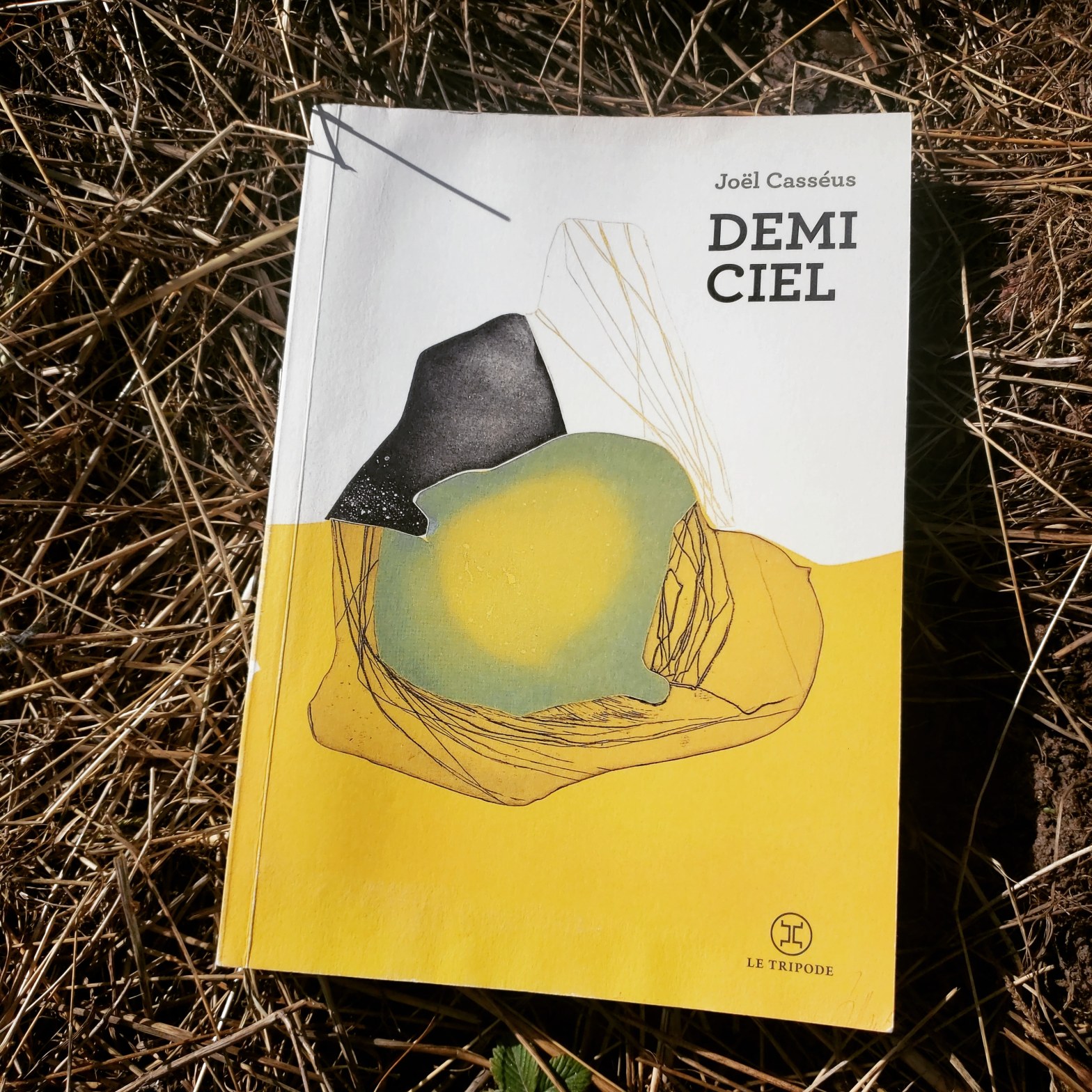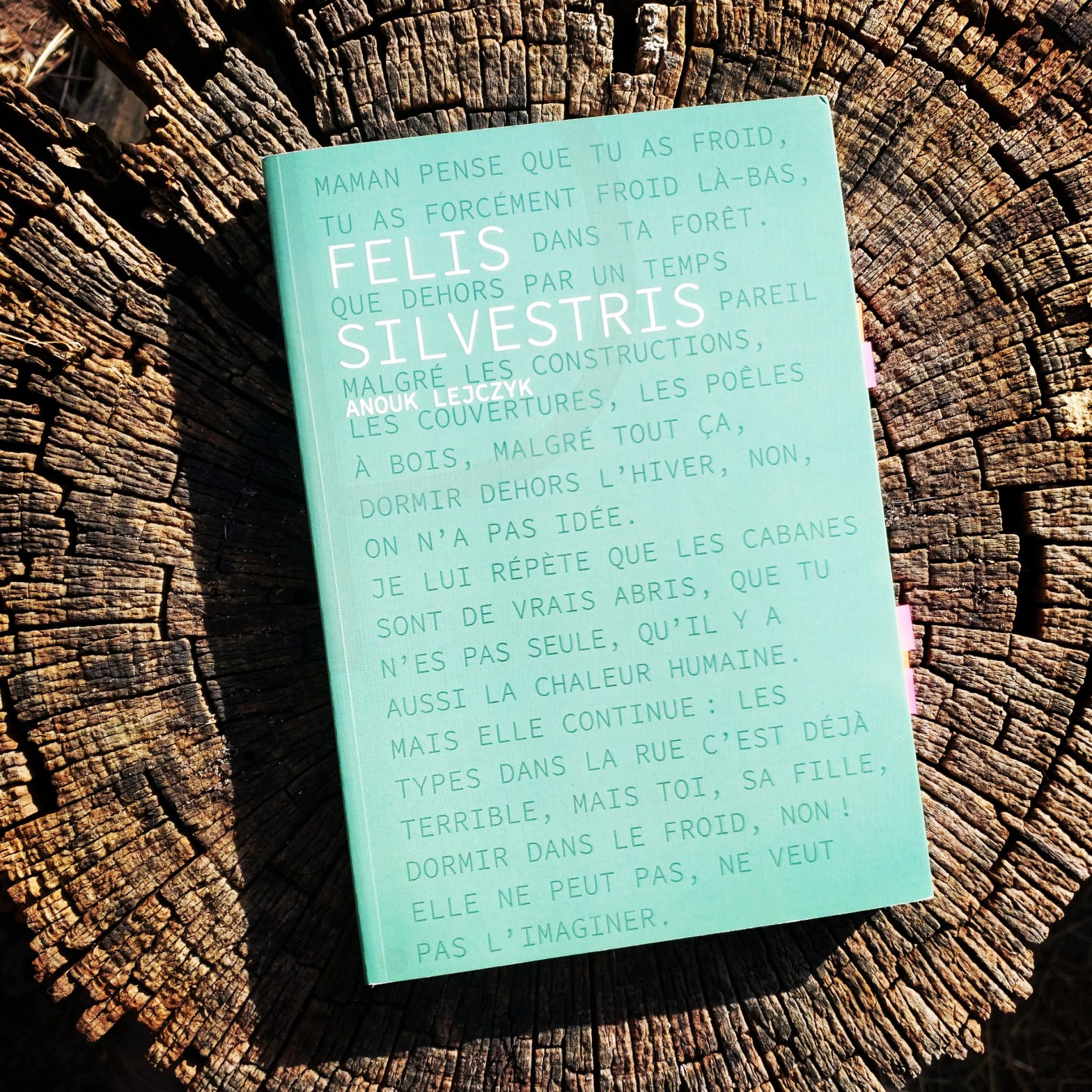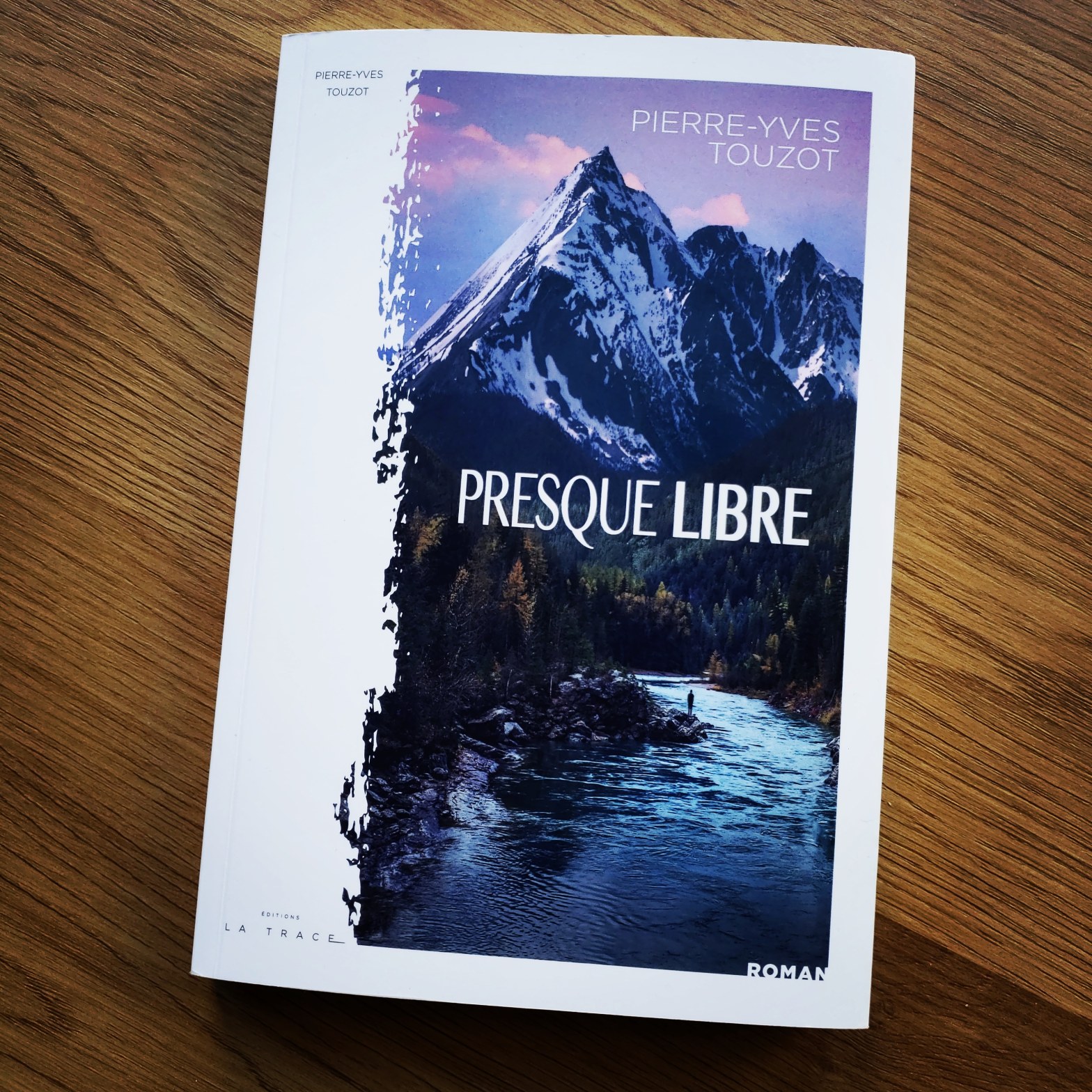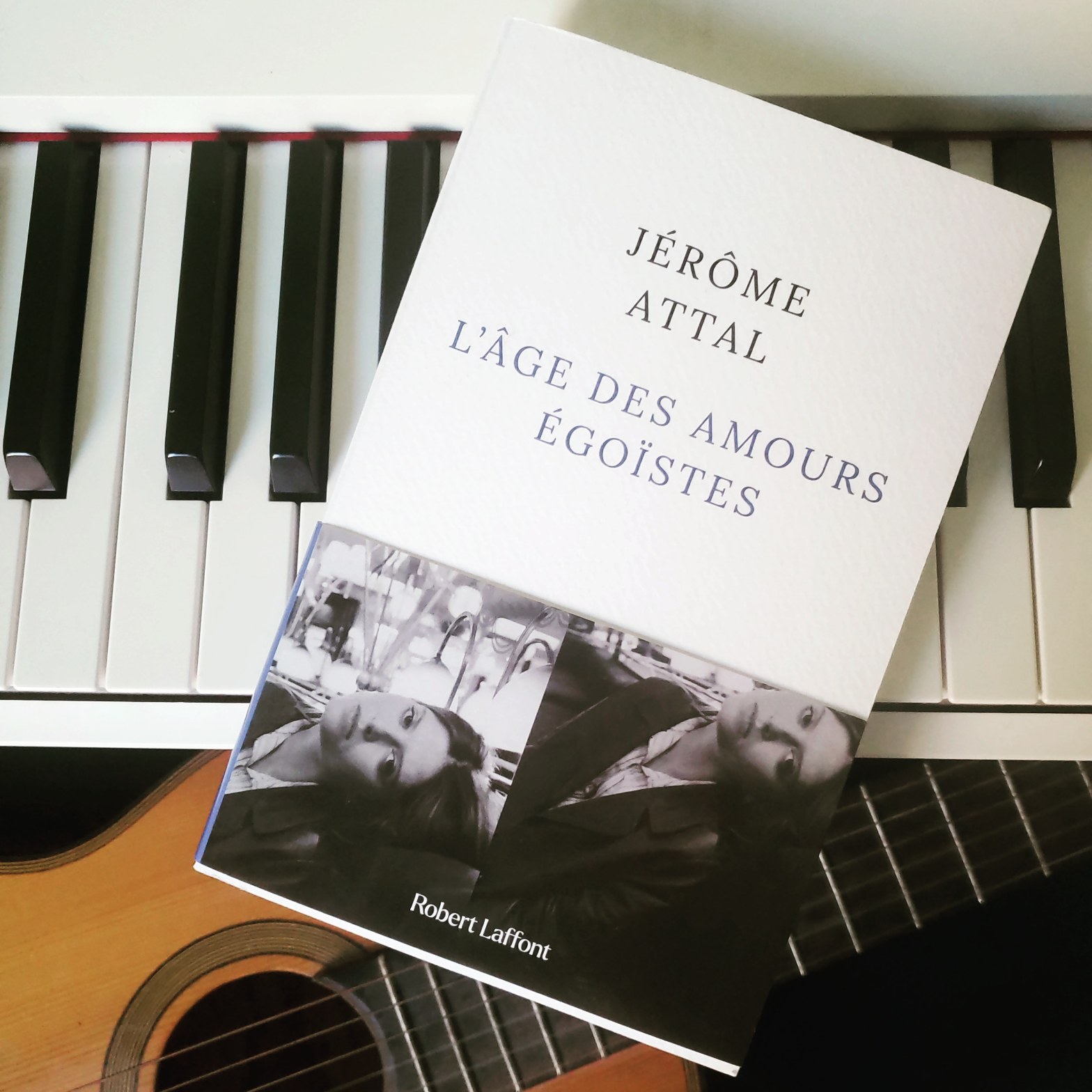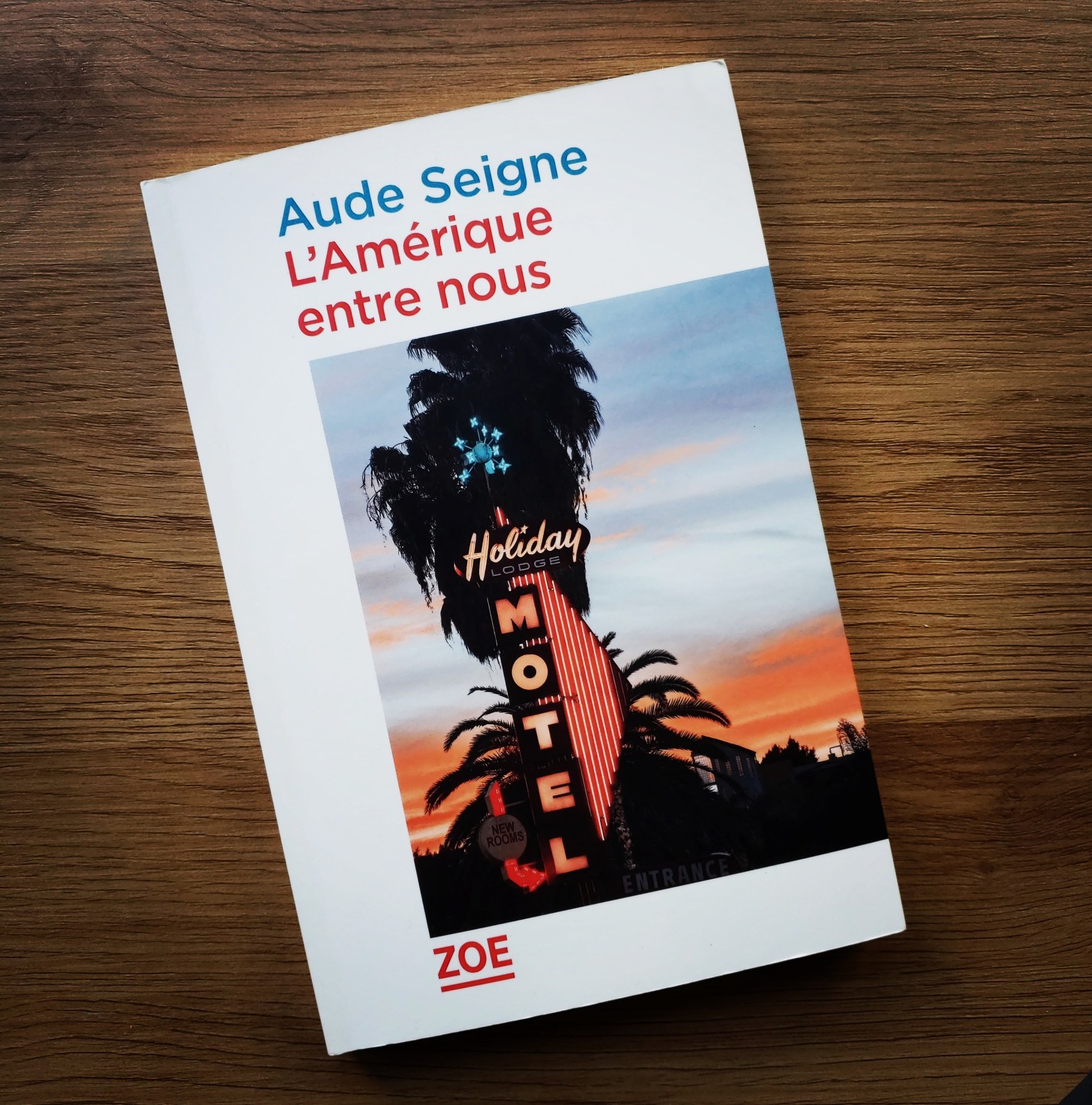De retour de Paris pour le jury du Prix Orange du Livre, j’attendais la publication officielle de la liste pour vous en parler !
Le jury s’est retrouvé au Café des éditeurs pour échanger et voter pour ses livres préférés. Une matinée très sympathique qui nous a permis de nous rencontrer en vrai ! Il faut préciser que pour le jury de l’année dernière tout s’est fait en visio.
Pour rappel, la composition du jury :
- Le président du jury est Jean-Christophe Rufin.
- Les auteurs sont Constance Joly (lauréate 2021), Florent Oiseau, Lilia Hassaine, Salomé Baudino et Jean-Baptiste Andréa.
- Les libraires sont Jérémy Demy (librairie L’Impromptu à Paris) et Antoine Bonnet (librairie Michel à Fontainebleau).
- Les 6 autres lecteurs : Laurence Bandelier, Thomas Besson, Rachida Bouchemoua, Christelle Grelou, Geneviève Munier et Julien Veron.
- La nouveauté : un comité de lecture avec d’anciens jurés qui comptera pour une voix.
Je suis très contente que mes 2 coups de cœur soient dans la liste : « L’autre moitié du monde » de Laurine Roux et « Les maisons vides » de Laurine Thizy. Je n’ai malheureusement pas réussi à défendre « Felis Silvestris » d’Anouk Lejczyk que j’ai beaucoup aimé, ni « De nouveaux endroits » de Lucile Génin, qui ne figuraient pas parmi les envois de la Fondation Orange.
J’avais stratégiquement mis de côté 4 livres qui pour moi seraient dans la sélection, donc au deuxième tour. Et ils le sont effectivement. Je vais de ce pas lire : « Les ailles collées » de Sophie de Baere, « Au café de la ville perdue » d’Anaïs Llobet, « Qu’est-ce que j’irais faire au paradis » de Walid Hajar Rachedi et « Presque le silence » de Julie Estève.
Ce jury littéraire est une très belle expérience pour moi. Nous avons une très belle cohésion d’équipe entre jurés lecteurs. Notre président a été parfait. Jean-Baptiste Andréa est très drôle, j’ai adoré sa franchise. J’en ai profité pour faire dédicacer le livre de Constance Joly et celui de Jean-Christophe Rufin. Et j’ai hâte d’échanger à nouveaux avec tous les jurés. Merci Françoise et Montserrat pour l’accueil et l’organisation au top. L’aventure se poursuit !
Les 20 romans sélectionnés
(par ordre alphabétique d’auteur)
- Les ailes collées / Sophie de Baere (JC Lattès)
- La Tour / Doan Bui (Grasset)
- Les nus d’hersanghem / Isabelle Dangy (Le Passage)
- Presque le silence / Julie Estève (Stock)
- Sauvagines / Gabrielle Filteau-Chiba (Stock)
- Tout est ori / Paul Serge Forest (Équateurs)
- Le sang des bêtes / Thomas Gunzig (Au Diable Vauvert)
- Qu’est-ce que j’irais faire au paradis / Walid Hajar Rachedi (Emmanuelle Collas)
- Je suis la maman du bourreau / David Lelait-Hélo (Héloïse D’Ormesson)
- Au café de la ville perdue / Anaïs Llobet (Editions de l’Observatoire)
- Le goût des garçons / Joy Majdalani (Grasset)
- Les accords silencieux / Marie-Diane Meissirel (Les Escales)
- Les écailles de l’amer Léthé / Eric Metzger (L’Olivier)
- Les silences d’Ogliano / Elena Piacentini (Actes sud)
- Pourquoi pas la vie / Coline Pierré (L’Iconoclaste)
- Portrait du baron d’Handrax / Bernard Quiriny (Rivages)
- L’autre moitié du monde / Laurine Roux (Les éditions du Sonneur)
- Les maison vides / Laurine Thizy (L’Olivier)
- L’homme sans fil / Alissa Wenz (Denoël)
Prochaine étape la sélection des 5 finalistes le 18 mai. Pour ma part, j’ai encore pas mal de lectures à faire mais je pense que c’est réalisable en deux mois. Et puis il va falloir affûter les arguments pour bien défendre nos coups de cœur. La matinée d’hier nous a donné un aperçu de l’énergie qu’il faudra pour convaincre tous les jurés, surtout les auteurs et les libraires.
Retrouvez toutes mes chroniques depuis le début du jury avec le tag « Jury Prix Orange du Livre 2022 » :
https://joellebooks.fr/tag/jury-prix-orange-du-livre-2022/
Pour en savoir plus
https://www.lecteurs.com/article/prix-orange-du-livre-2022-les-lecteurs-membres-du-jury/2444230
https://www.lecteurs.com/article/les-20-romans-en-lice-pour-le-prix-orange-du-livre-2022/2444260