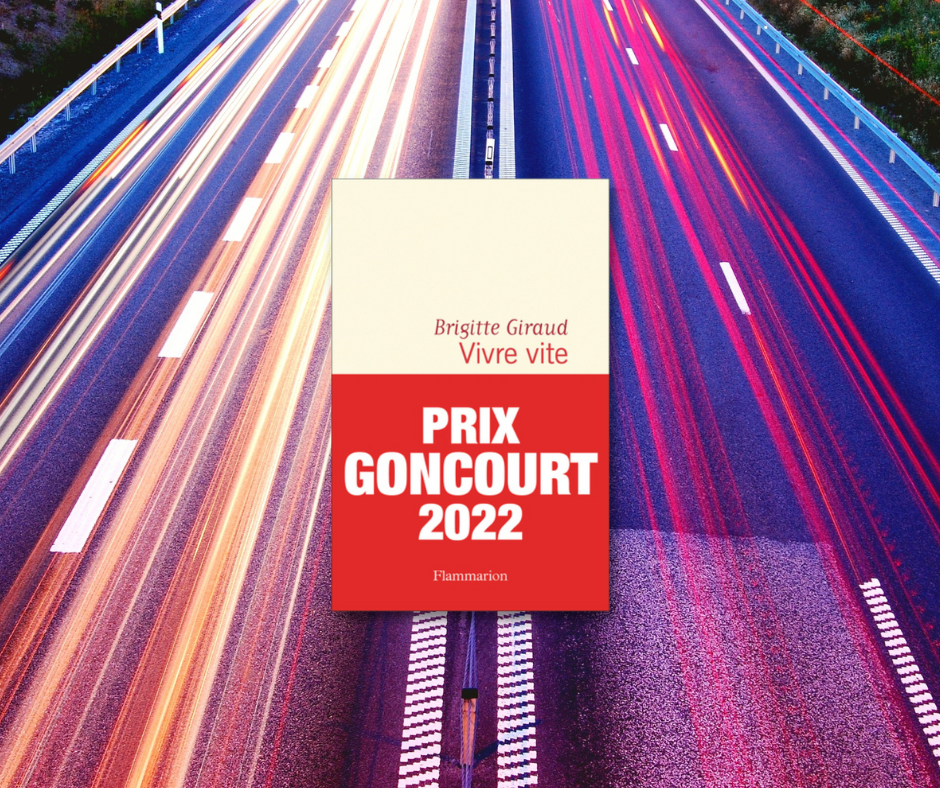illustré par les gravures d’Hélène Bautista
Une autrice doublée d’une maison d’édition chouchou, c’était impossible pour moi de manquer ce roman. En plus, je trouve que c’est une lecture idéale en cette période de fête. Imaginez-vous confortablement installés près d’un bon feu de bois avec une tasse de thé et une assiette de bredele avec ce magnifique roman, vous allez passer un bon moment assurément ! D’ailleurs vous pouvez tenter de le gagner cette semaine sur mon compte Instagram ! #jedisçajedisrien 😉
Laurine Roux, en formidable conteuse, nous fait traverser tout le 20ème siècle à vive allure. C’est une véritable saga familiale sur fond historique, avec de beaux portraits de femmes, le tout saupoudré de sciences, de fleurs et de philosophie.
Cette saga débute avec la naissance de Barthélémy Aghulon en 1850, le quadrisaïeul du narrateur, qui clôt le roman. Les chapitres sont courts et s’enchaînent, avec à chaque fois un titre évocateur commençant par « Où le… ». Le roman est divisé en 3 parties et comporte 372 pages. Je n’ai pas vu le temps passer. Il est rehaussé par les très belles gravures d’Hélène Bautista.
Avec beaucoup d’humour, de malice, un ton vif et enjoué, un langage familier, imagé et fleuri – quelques injures et jurons pleuvent – Laurine Roux raconte l’histoire épique de la famille Aghulon sur plusieurs générations. Les personnages, hauts en couleur, vivent des situations rocambolesques entre Paris et les Cévennes, que d’aventures Marguerite aura vécues ! Ce roman déborde de générosité et d’humanité, on ne peut que s’attacher aux personnages des Mûriers et avoir envie de goûter à ce fameux cru qui y est produit, l’Aïthops Oinos.
Vous y croiserez aussi des animaux, dans un zoo, mais surtout des chats philosophes que seuls certains membres de la famille peuvent comprendre. Comme tous les amoureux des chats, je rêve de pouvoir parler avec le mien !
On y parle donc de vin, d’animaux, de sciences, de fleurs, de musique, de bonne cuisine et l’amour n’est jamais très loin.
La signification du magnifique titre est révélée à la toute fin par le narrateur, Gabriel.
On sent que l’autrice s’est amusée à écrire cette histoire, à jouer avec les mots. Je retrouve cette plume que j’ai tant aimée chez Alexandre Dumas notamment. Quel plaisir de lecture !
Toujours écrit avec une très belle plume, chacun des romans de Laurine Roux est différent et tous m’ont plu. Je me demande quel sera son prochain roman. En tout cas je me laisserai surprendre et je serai au rendez-vous !
Êtes-vous tentés par cette lecture ? L’avez-vous lu ?
Prologue :
« où Gabriel ne pleura pas la trisaïeule (12 septembre 2001)
Mamita est morte ce matin. Hier, à la télé, ils ont coupé les dessins animés pour montrer des avions qui explosaient sur deux grosses tours en Amérique. Tout le monde avait l’air choqué, et Maman n’arrêtait pas de dire, Oh mon Dieu oh mon Dieu. Moi, j’ai bien aimé les pompiers. Quand Papa a appris la nouvelle pour Mamita, il a dit, C’est un troisième monument qui s’écroule. J’ai pas compris le rapport avec les deux tours. »
« Maintenant, je vais pouvoir jouer au foot. C’est pas très sympa – je sais, merci -, parce que Maman a beaucoup de peine. Seulement, Mamita était comme un vieux meuble qui tombe en miettes : poussiéreuse et complètement déglinguée. »
« – Bien, bien. Je suis néanmoins curieux de connaître l’étonnant phénomène météorologique qui a crotté mademoiselle alors que le temps est plus sec qu’un décret de Nicolas II. »
« Laissée sans boussole après le suicide de son père, et craignant de devenir folle à son tour, Marguerite se boucha les oreilles et se répéta la sentence de feu Socrate, Le temps malgré tout trouvera la solution malgré toi. »
« Et, au printemps 1937, malgré des adieux déchirants avec sa femme, il s’envola pour les tropiques. Quand l’avion disparut dans le ciel, la poitrine de Marguerite se craquela. Vingt-sept ans après leur première rencontre, et nonobstant les excentricités de son époux, son cœur battait encore pour lui comme le double myocarde d’une girafe. »
« L’ancienne aumônerie reconvertie en cantine ne désemplissait pas. Le cuistot n’avait pourtant pas cherché les honneurs. Ses menus familiaux se voulaient modestes et discrets. Seulement, ses paupiettes aux épinards faisaient un tabac : le croustillant de la barde de lard contrastait avec la tendreté du veau, enveloppait la farce mieux qu’un papier cadeau, et quand on atteignait le cœur, les arômes de garrigue – laurier, origan – vous émouvaient si joliment la glotte que pour trois francs six sous on approchait, sinon le paradis, du moins la Provence. »