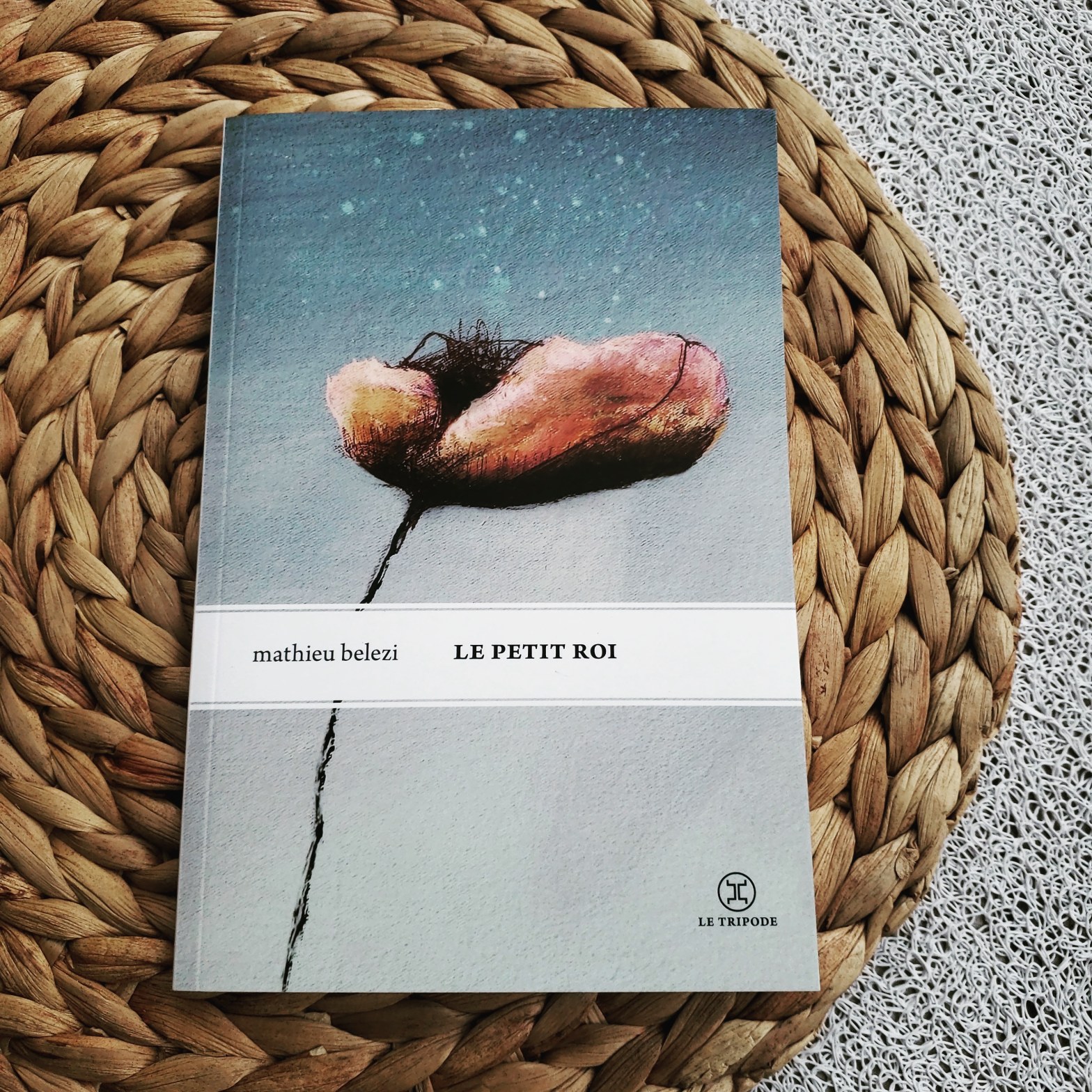Entre récit intime et roman, ce livre m’a totalement happée le temps d’un après-midi. Je l’ai littéralement dévoré !
La narratrice raconte une sorte de légende familiale, son arrière-grand-mère serait « morte de chagrin, le cœur brisé » suite aux décès de ses 2 fils puis de son mari. Sa mère entame des recherches généalogiques mais ne maîtrisant pas Internet, elle ne va pas au bout de son entreprise. Alors la narratrice saisit dans un moteur de recherche connu le nom de son aïeule et découvre des dates différentes qui dévoilent qu’elle a vécu âgée : Anne Décimus 1875-1964. Alors pourquoi sa grand-mère se dit orpheline et pourquoi a-t-elle été confiée à un orphelinat ?
Elle n’obtient aucune réponse de sa grand-mère dont la mémoire sombre. Peu à peu elle va rassembler les pièces du puzzle de la vie d’Anne Décimus. Elle consulte les archives, demande des autorisations. A force de patience et de ténacité, la lumière sur ce secret de famille se fait.
C’est tout simplement passionnant. On suit le cheminement de la narratrice. On vibre avec elle lors de ses découvertes. Et bien sûr on se pose aussi des questions.
C’est le premier roman de Stéphanie Dupays que je lis et j’ai très envie de lire ses précédents. D’ailleurs son premier roman a fait partie d’une sélection des 68 premières fois, un signe qui ne trompe pas !
Et quel titre ! Magnifique. Les titres de chapitres sont aussi très beaux et correspondent à des livres dont la liste se trouve en fin d’ouvrage.
« On traverse des nuits qui vous changent de règne »
« Comment rassembler les milles infimes débris de chaque homme »
« Tu sais que c’est l’obscur de ton cœur qui guérit »
J’ai beaucoup aimé ce roman, un peu moins la deuxième partie qui aborde l’histoire des établissements psychiatriques et de la psychiatrie. Petit bémol qui en fait un presque coup de cœur de la sélection du Prix Orange du livre 2023 ! Parce qu’à la fin il doit en rester 5 puis 1 ! Le choix est rude.
Incipit :
Je viens de loin de beaucoup plus loin qu’on ne pourrait croire
« C’est une famille restreinte, quelque peu ratatinée, que la mienne. Mes parents, ma grand-mère et moi. C’est tout. Depuis sa retraite, ma mère a entrepris d’y ajouter des ascendants puisque je lui refuse les descendants : elle s’est mise à la généalogie. »
« Je ne sais ce qui est le pire : pour Anne, d’avoir vécu séparée de ses filles, rejetée par sa famille ou, pour ma grand-mère, d’avoir été trompée quant à la mort de sa mère. Je songe à tout ce dont elles ont été privées : amour, réconfort, sécurité, et j’en ressens une tristesse infinie. Chaque fois que je pense à cette histoire, ma poitrine se gonfle de toutes les larmes que le mensonge à fait couler à l’asile comme à l’orphelinat. C’est un chagrin enfoui de longue date qui remonte, clandestin, irrépressible, et qui me serre la gorge.
Moi aussi je suis – un peu – privée de quelque chose. Par contagion. Je ne sais précisément nommer la perte. Ce n’est évidemment pas une douleur semblable à celle d’un deuil. Il y a une perte tout aussi palpable bien que différente. Une image tourne dans mon cerveau. Le choc d’une balle sur un pare-brise. A partir de l’impact central, la brisure se propage en une étoile constellée de minuscules cristaux. Très loin dans le temps et dans l’espace, l’onde de choc a fêlé quelque chose en moi. »
« Un je-ne-sais-quoi grondait et on ne pouvait l’exprimer avec des mots. Il faut dire que des mots, il n’y en avait pas beaucoup. Dans ma famille on parle peu. C’est peut-être pour cela que j’ai très tôt et voracement cherché dans les livres à combler ce déficit de langage. »
« Je voyais bien que ma grand-mère avait cédé à contrecœur, sans comprendre pourquoi. Unique petite-fille, j’ai été pour ma grand-mère, au milieu de tous ses morts, bien plus qu’une enfant. J’étais le pain blanc après des décennies de pain noir, le retour du balancier, la revanche sur un destin jusque-là peu favorable, le bouclier entre elle et l’épouvante. J’ai aussi été le réceptacle de toutes ses angoisses : chaque famille infantile, chaque accident bénin suscitait une inquiétude disproportionnée. Et si la trêve inespérée du sort prenait fin aussi subitement qu’elle avait commencé ? »
« Certains jours on vit
comme un tableau d’Edward Hopper
il y a cet immense silence
et cette lumière blanche qui dépouille
plus qu’elle n’éclaire
et une sourde inquiétude se glisse dans les failles
comme la fumée et la pluie »
« Puis, à la bibliothèque, je tombe sur Une histoire familiale de la peur d’Agata Tuszynska qui raconte un phénomène similaire. Une fois de plus, le livre qu’il me fallait lire se glisse entre mes mains au bon moment, comme par enchantement, volant au-devant de mes questionnements intimes. »
« Comme la mémoire individuelle, la mémoire collective garde ou supprime, volontairement ou inconsciemment. Archiver c’est choisir. Décider des traces qui méritent d’être conservées. C’est un geste d’une grande violence d’effectuer ce tri entre ce qui est digne d’intérêt pour un chercheur futur et ce qui ne l’est pas. Ce qui échappe à l’archive est réputé sans importance et perdu pour toujours. »
« L’épigénétique a montré que les épreuves, les chocs, les deuils qu’ont vécus nos ancêtres ne se lèguent pas seulement par le climat familial ou la fréquentation des personnes mais marquent le patrimoine génétique qui se transmet de génération en génération. Je lis le compte-rendu de la curieuse expérience menée par des chercheurs d’Atlanta. Les scientifiques ont fait sentir des fleurs de cerisier à des souris tout en provoquant des stimuli douloureux. Ces souris se sont mise à craindre cette odeur spécifique. Plus surprenant, leurs descendants jamais soumis aux stimuli ni aux fleurs de cerisier développent eux aussi une réaction de stress et de rejet face à cette odeur. »
« Quand je ne sais que penser, j’écris. Je tente de retrouver les quelques faits en lambeaux dont je dispose, comme on dit « retrouver ses esprits ». Dans l’espoir naïf d’y voir surgir un sens. Et quand l’émotion déborde de la phrase, je l’attrape dans le vers.
Peut-être que si je l’écris ça ira mieux
Je ne sais pas
exactement ce que
« ça »
désigne
Peut-être que je m’invente
des nécessités un but une direction
pour apprivoiser le temps
j’essaie
je n’ai rien à perdre
Qu’est-ce que je cherche à sauver
mon arrière-grand-mère
ma grand-mère
ma mère
moi ?
Ecrire est :
la seule manière de regarder
la réalité
sans qu’elle s’abatte sur moi
comme une maison en flammes
la seule manière de retrouver ce qui est
perdu
dans les décombres »
« Quand on lui demande de parler de sa mère, elle dit qu’elle est morte de chagrin, le cœur brisé. C’est la meilleure version de l’histoire, celle qui a le pouvoir de réparer tous les dégâts. Chacun s’arrange comme il peut avec la souffrance. »