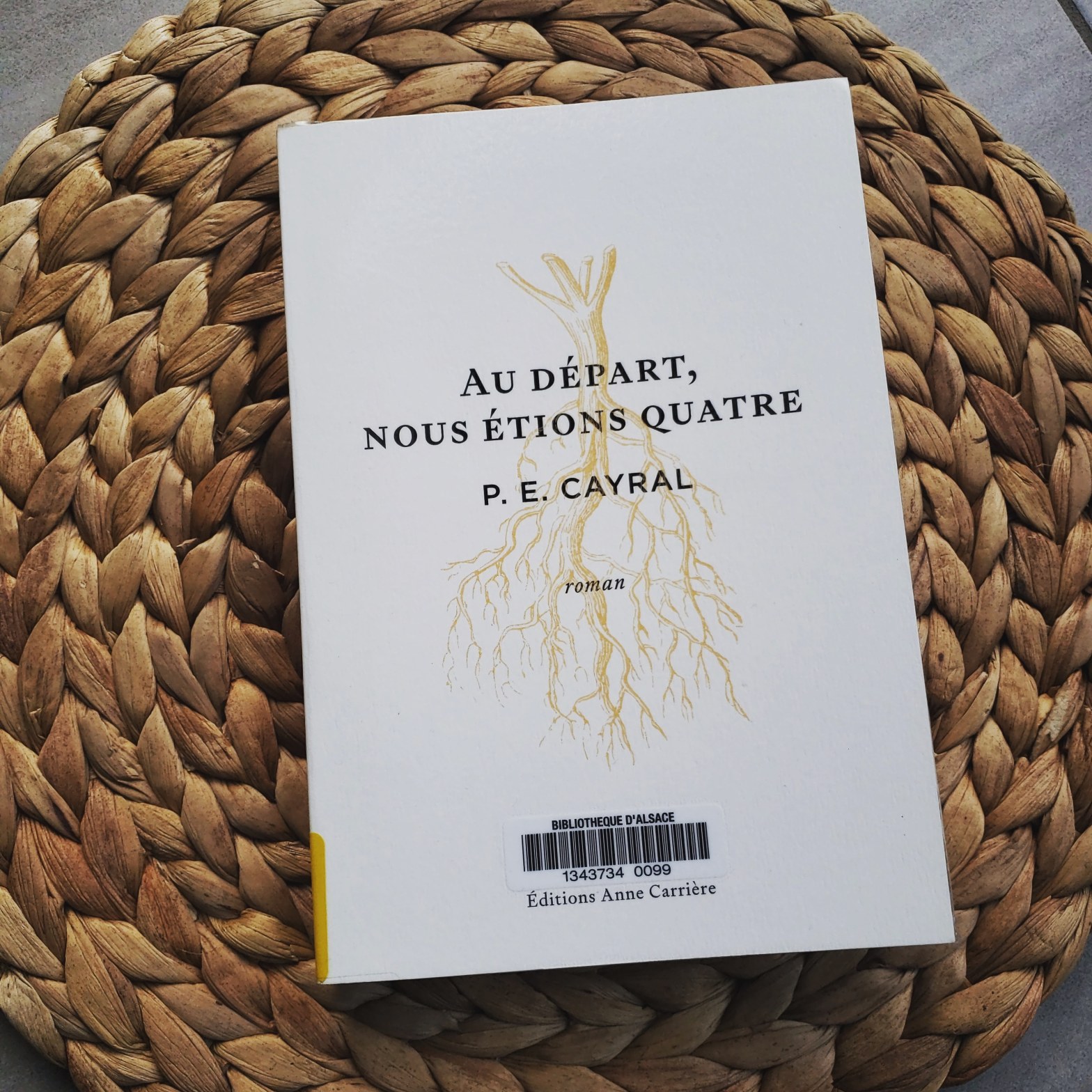Ce roman nous plonge dans les grands espaces du Canada, qui paradoxalement enferment ses personnages. Ils sont comme empêchés de partir de Val Grégoire. Leurs pères ont fui, abandonnant femmes et enfants. Une sorte de fatalisme s’abat sur eux. La vie est rude : chômage, alcoolisme, femmes trompées, délinquance, etc.
L’histoire tourne autour de l’amitié de trois enfants : Marco, Louise et Laurence. Ils rêvent d’échapper à leur destin et de quitter Val Grégoire. Devenus adolescents, un événement (que je vous tais pour ne pas divulgâcher) va les séparer. Les parents de Louise partent précipitamment de Val Grégoire avec Louise et ses sœurs. Louise aura pour unique objectif de revenir et de retrouver ses amis. Et puis les « circonstances » comme le dit l’auteur, changent le cours des choses.
Difficile de parler de ce roman sans trop en dévoiler. En tout cas j’ai trouvé l’histoire originale et prenante. La structure du roman également car elle n’est pas linéaire. On passe d’un point de vue à l’autre des personnages habilement, en alternant le présent et le passé. Les parties sont entrecoupées du point de vue des ouananiches, ces enfants, camarades du trio d’amis qui sont toujours restés à Val Grégoire et ont compris eux : « nous, natifs de Val Grégoire, étions condamnés à ne jamais pouvoir partir d’ici ». Peu à peu on retrace la vie de Louise, Marco et Laurence. Louise est solaire, forte, tenace, impossible de ne pas s’attacher à cette jeune fille.
Nicolas Delisle-L’Heureux dans ce second roman parle très bien de l’amitié et de l’adolescence. Il interroge la reproduction du schéma familial, le déterminisme social, peuvent-ils échapper à leur destin ? Il est aussi question de vengeance, du rapport entre femmes et hommes, de familles dysfonctionnelles, de Wendy, la sœur de Laurence, handicapée mentale. J’ai aussi beaucoup aimé les mots et expressions québécoises. L’écriture est vive et inventive, bref c’est une voix singulière. Ce roman peut paraître noir mais il se révèle aussi drôle par moment et il y a toujours une lueur d’espoir. Impossible de savoir ce que les personnages vont faire ou dire, je me suis laissée totalement embarquer, porter par la plume de cet auteur canadien. Encore une belle découverte grâce aux Avrils.
Un coup de cœur lu dans le cadre du Prix Orange du Livre 2023 !
Prologue :
« Il y a trois semaines, Wendy a vu Mémère accoucher en silence dans le garage. Pas ne plainte. Les chatons sont apparus comme des gens qui se penchent pour passer une porte un peu basse, un, deux, trois, quatre. Ils étaient tellement beaux que Wendy en avait mal en arrière des genoux. »
Ouananiches I
« Val Grégoire est un rond-point d’environ cinq kilomètres. La rue Principale a la forme d’un lasso, ou d’une corde pour se pendre, ce qui influence le moral général. »
« Évelyne eut beau placer leur fils sous la gouverne d’un précepteur dès qu’ils arrivèrent à Val Grégoire, Jean-Marc n’aima pas l’école et l’école ne l’aima pas. Les descendants Desfossés seraient tous d’incurables illettrés et Jean-Marc ferait de son manque de classe crasse sa marque de commerce. Il avait grandi pour devenir alcoolique et, déjà, à pas même vingt ans, il se montrait aussi prévisible que s’il avait eu la soixantaine et des marottes. A la Brasserie du Nord, il rencontra Marie-Pierre, une grande brune malséante et écornifleuse de Baie-Comeau qui aurait pu faire actrice, mais qui avait une dentition exécrable et qui se flétrissait la peau avec la cigarette. Entre 1972 et 1978, ils préparèrent sans le vouloir le désastre à venir, engendrant coup sur coup, comme de vilains lapins, sept garçons : Ricardo, Julio, Bruno, Théo, Mario, Léo et Marco – ils expliquaient, avec le plus grand sérieux : « Le o, c’est pour l’onneur. » Marie-Pierre organisait toutes sortes d’activités afin de canaliser la testostérone manufacturée par les treize testicules de ses sept fils et Jean-Marc leur faisait boire de la bière dès qu’ils brandissaient le moindre poil. Tout ce qui survenait dans leur maison, à l’époque, était nimbé d’une aura de frénésie jaune orange et ça brûlait les yeux à regarder. »
« Plus de cinquante ans après l’inauguration de Val Grégoire, nos mères n’ont pas bougé et semblent désormais n’avoir pour seule fonction que de s’inquiéter pour nous, devenus adultes, et pour notre progéniture, sur le point de l’être. Les rues, le centre communautaire et les halls des écoles portent les noms de leurs maris, mais ce sont elles qui ont affronté les hivers du Nord et nos récidives canailles. Elles ne sont pas malheureuses, elles le jureraient, juste un peu mélancoliques – elles préfèrent le terme fragiles et contribuent à sept pour cent de l’économie pharmaceutique de l’est du pays. »
« Nous savions ses racines et sa souche, à Marco, et nous sentions depuis toujours qu’il aurait dû appartenir à un autre arbre généalogique. Il était né avec un patronyme qui était comme des cannettes vides attachées à ses jambes, ça faisait kakling-kakling partout où il passait. Sauf que sa réputation le concernait à peine. Il découlait, septième, d’une lignée guerrière, copie carbone des autres Desfossés, le même format, à la différence que, enfant, il exécrait la chasse parce qu’incapable de tuer et se portait, justicier, à la défense des plus vulnérables. Son père roulait les yeux de honte, ses frères l’assaillaient de pichenottes et il devint le préféré de sa mère. Nous l’avions vu se forcer à se transformer, nous l’avions vu commencer à serrer les poings, à regimber contre les professeurs, à chercher la pagaille. Son clan s’est soudé à mesure qu’il devenait ce qu’il n’était pas et qu’il tentait de renier une faculté dont nous étions tous dépourvus et que nous cherchons avidement depuis : l’empathie. Mais le problème avec soi-même, c’est qu’on naît sur une île minuscule dont on a vite fait le tour et que tout ce qu’on jette à la mer revient invariablement s’échouer sur le sable. »
« La vérité comme nous le comprendrions plus tard était que les seuls qui parvenaient à quitter la ville, même pour une simple petite nuit, étaient des adultes célibataires ou des parents en vacances de leur progéniture. Autrement dit, l’expérience nous démontrait peu à peu que nous, natifs de Val Grégoire, étions condamnés à ne jamais pouvoir partir d’ici. »
« Quelque chose faisait donc défaut à Val Grégoire et ça sentait tellement fort que ça débouchait les narines, mais l’origine exacte du remugle restait imprécise. Nous ignorons qui parmi nous a trouvé l’explication la plus plausible, mais nous y avons tous adhéré en bloc : nous étions nés humains, nous mourions ouananiches. »
« Comme nos parents, nous sommes des pêcheurs du dimanche, et le chômage étant endémique, c’est dimanche souvent : nous avons cultivé notre talent. Nos pères, en nous quittant, nous ont légué leurs gréements pour seul héritage. Nous connaissions donc tous, et depuis jeunes, la ouananiche dont nous aimions la chair rose et grasse. »
« Durant un certain temps, Marco et Laurence tentèrent à deux de sauvegarder ce qu’ils avaient bâti à trois, mais ce qu’on appelle les circonstances ne les avaient pas seulement détroussés de Louise, elles les détourneraient aussi l’un de l’autre. C’est comme marcher les yeux bandés dans un champ de foin très long et très plat : on dévie à coup sûr. »
« En quelques années, le désespoir des habitants de la région s’était mué en spiritualité de bas étage et Mercedes réussissait désormais là où, à peine une décennie plus tôt, les Fowley avaient échoué – il avait suffi de placer la transformation de l’individu au centre du culte pour remettre la même culpabilité toute religieuse au goût du jour. »