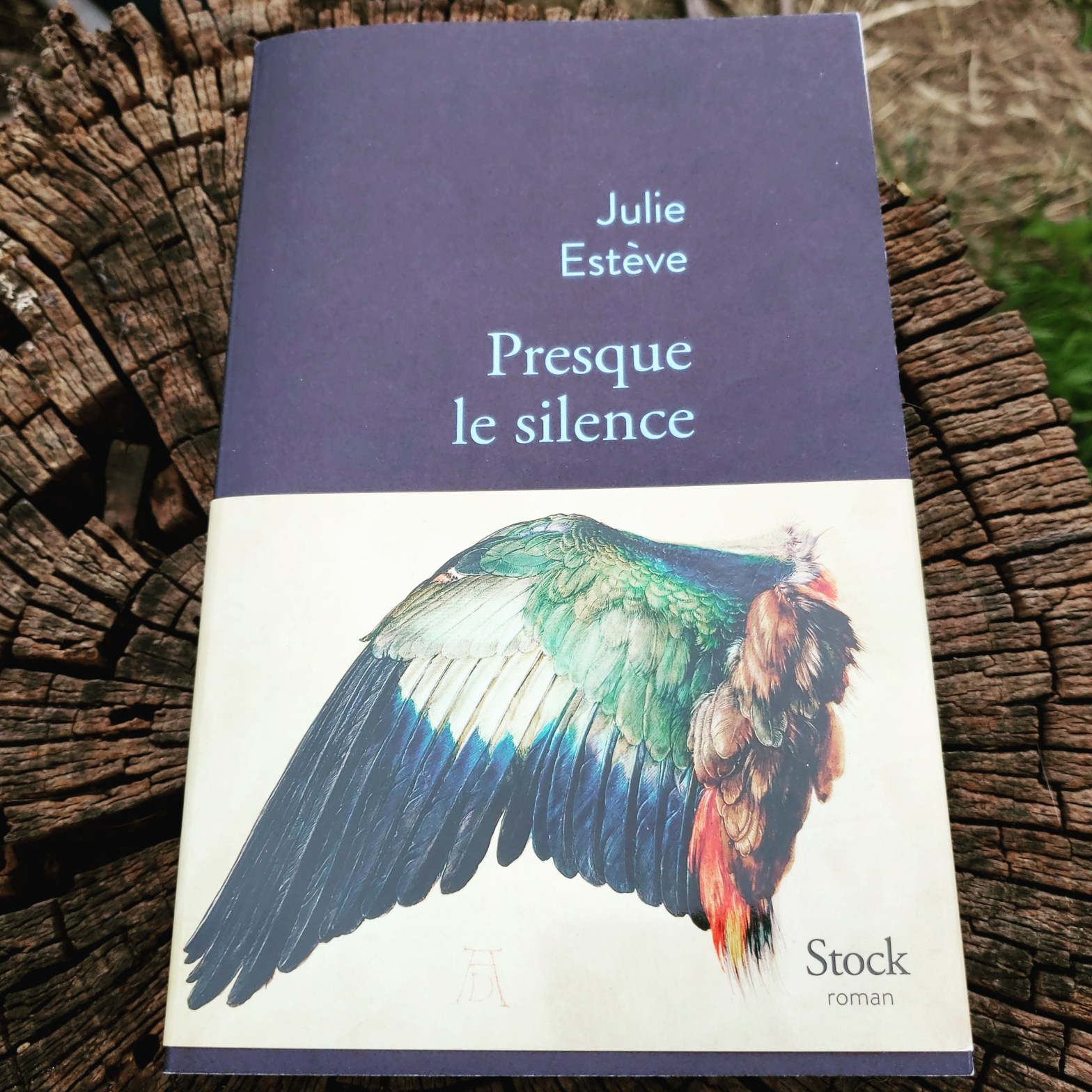Nous sommes en France, Malek Bensayah, son bac en poche, décide de faire un voyage pendant l’été avec toutes ses économies et d’aller en Algérie, terre de ses ancêtres, en passant par l’Espagne, etc. Sorte de quête ou de voyage initiatique. Il rencontrera Kathleen a plusieurs reprises durant son voyage. Il tombera amoureux de cette anglaise. Avec sa maladresse, il aura bien besoin d’un coup de pouce du destin pour pouvoir la revoir.
Ce roman comporte plusieurs histoires, celles de frères en Afghanistan, celle de Malek, celle de Kathleen et de son père travaillant pour une ONG, etc. Toutes sont liées. Mais je n’en dis pas plus pour ne pas divulgâcher.
La force de ce livre est de nous faire passer de pays en pays en nous éclairant sur l’histoire et la situation géopolitique de chacun. Il offre plusieurs points de vue. J’ai bien aimé le passage où Kathleen et son père parlent des manuels d’histoire et de la façon dont chaque pays interprète et s’approprie l’Histoire. J’ai d’ailleurs mis l’extrait en question sur le blog.
J’avais deviné la fin donc je ne peux pas dire que j’ai été surprise par ce roman. Par contre j’ai aimé accompagner Malek dans son voyage même s’il m’a semblé quelque peu invraisemblable. La plume de Walid Hajar Rachedi a su m’emporter. Il fait preuve d’humour et je dirais d’une certaine fraîcheur ou candeur à travers le regard de Malek qui font du bien. C’est rythmé et fluide, parsemé de poésie et de philosophie. Et il y a même une ode à la littérature et à la lecture, donc en tant que bibliothécaire ça me touche. J’apprécie les livres publiés par Emmanuelle Collas car ils permettent d’avoir un autre regard sur le monde, une ouverture.
Un premier roman très intéressant, bien écrit et en lice pour le Prix Orange du Livre 2022 ! Il a fait une forte impression auprès de mes camarades jurés lecteurs.
Incipit :
« Gamin, j’avais côtoyé Ali pendant ces quelques étés algériens. Loin de ma cité des peupliers. Loin des Stains.
1991, le dernier été avant la décennie noire. J’avais sept ans, lui quinze.
Dans mon souvenir, on aurait dit un adulte avec une espièglerie d’enfant. Là-bas, l’adolescence n’existait pas vraiment. Il y avait une route qui séparait la vie en deux. Devant la maison, un terrain de jeu, le chahut et les fous rires ravageurs. En face, un minuscule café devant lequel se tenaient des hommes. Du jour au lendemain, on basculait de l’autre côté comme si, pendant la nuit, quelqu’un était venu vous souffler à l’oreille le rôle que vous deviez désormais tenir. Très vite, au bout des doigts, s’imprimaient les mêmes taches jaunes des clopes trop goudronnées. Sur les tables bancales mordant sur la route s’éternisaient les mêmes kawas serrés. A chaque nouvelle gorgée, les yeux se plissaient davantage, les pupilles devenaient mornes comme abreuvées d’un élixir de lucidité.
Mais Ali était différent. Il avait traversé la route, tiré sur ses premières cigarettes, trempé ses lèvres dans le liquide noir mais, dans ses yeux à lui, subsistait quelque chose de brillant. »
« Juste un mur bordant la plage côté nord où s’écrasent les lumières des ferries. Juste un mur fermant la mer jusqu’aux confins de l’espace Schengen, au pied duquel apparaîtront bientôt ceux qui n’ont rien à perdre que leur vie. Et Atiq, si proche de l’Angleterre, si loin de son frère, se demande combien de temps encore il lui faudra s’enfoncer dans l’impasse du monde sans ciller. »
« J’étais glacé par ce qui s’était passé en ces lieux, par le nombre de victimes, par leurs noms qui n’en faisaient plus de simples anonymes et, plus encore, par l’idée que certains, comme Wassim, le frère d’Atiq, pouvaient trouver que c’était de bonne guerre, que ce n’était qu’une réponse au chaos engendré. Car, avec l’Angleterre, l’Espagne était l’autre pays du G7 qui avait soutenu à l’ONU l’idée américaine d’une intervention en Irak. »
« Au lycée, j’avais bien réussi à transformer ma quarantaine au CDI en un incroyable voyage immobile. Intrigué par les yeux des lecteurs qui s’illuminaient, leurs mains fébriles sur les pages des livres, j’ai voulu me faire ma propre idée. Malgré les présentoirs ostentatoires et les bandeaux rouges arrogants, j’ai fini par en feuilleter quelques-uns. Surpris de la surprise de ceux qui me voyaient lire, j’ai eu la sensation de goûter à l’eau d’une fontaine à laquelle je n’étais pas censé m’abreuver. Comme une transgression. Au fil des semaines, la curiosité a viré à la boulimie, je dévorais tout ce qui me tombait sous la main. Je suis parti aussi loin que pouvait me porter mon imagination. J’ai vécu mille vies, visité mille lieux. Le plus troublant était que je ne reconnaissais pas des endroits censés m’être familiers. »
« Autre conflit, autres protagonistes, mais toujours le même résultat : une haine qui n’en finit pas. »
« Comment ne pas souhaiter, l’espace d’un instant, à l’instar du plus véhément des jumeaux, que « le chaos retourne à sa source » pour qu’il arrête de se propager dans ma tête ? »
« Le lendemain, je me suis réveillé à l’aube. J’avais hâte d’arriver à Tarifa pour prendre le bateau et découvrir Tanger. Sofia était déjà levée, elle profitait du calme matinal avant le réveil des pensionnaires. Elle m’a préparé un café, des tartines. Elle m’a demandé d’un air énigmatique :
« Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher ?
– Qui vous a dit que je cherchais quelque chose ?
– Tu as les yeux de celui qui cherche.
– Là, je voudrais surtout chercher un miroir pour vérifier si c’est vrai ! »Elle a souri avec les yeux. Ça m’a donné envie de lui dire ce que j’avais sur le cœur :
« Si je cherche quelque chose, je ne sais pas ce que c’est.
– Quand tu l’auras trouvé, tu sauras que c’est bien ça que tu cherchais.
– Et si je ne trouve pas ?
– C’est qu’il n’y avait peut-être pas à chercher, que tu avais déjà tout en toi. »J’ai eu un pincement au cœur au moment de partir, comme si on se connaissait depuis longtemps. »
« Je sais seulement que lorsque j’ai de nouveau entendu le son acidulé de la voix de Kathleen, ce qui nous entourait avait disparu un instant, et je me suis senti enveloppé par quelque chose de doux, inédit et étrangement familier. Je me suis senti comme protégé. Et j’ai pensé à ce verset du Coran qui dit de l’être aimé qu’il est un vêtement pour soi, comme on est un vêtement pour lui.
C’est peut-être ça, l’amour : un abri. »
« Toutes les histoires ont déjà été racontées, il n’y a que la voix de celui qui raconte qui change. »
« « Mais, Papa, t’entends ce que tu dis ! Donc tout ce qu’on nous raconte ne serait qu’un tissu de mensonges ? Big Brother, quoi ! à ce compte-là, on n’a plus qu’à jeter tous les livres d’histoire à la poubelle…
– Mais l’histoire, ma fille, c’est un récit. Un récit qu’un peuple se raconte à lui-même. Un récit qui a ses biais. Tu sais ce que disait Churchill sur l’histoire ?
– « L’histoire est écrite par les vainqueurs », c’est ça ?
– Et tu crois qu’il avait tort ? Qu’est-ce que tu vois par la fenêtre ?
– L’entrée de la gare de Waterloo ?
– Et Waterloo, c’est quoi pour nous, Waterloo ? C’est le nom de la bataille qui a défait Napoléon, qui a défait un tyran. « Napoléon le tyran », est-ce que tu crois que c’est ce qu’apprennent les petits Français à l’école ? Non, dans leurs livres, Napoléon, c’est un héros, le bâtisseur de l’Europe, le dernier empereur français, inhumé tel un pharaon aux Invalides… Et la gare qui porte son souvenir à Paris, comment s’appelle-t-elle ? Waterloo ? Non, bien sûr, c’est la gare d’Austerlitz ! Austerlitz, du nom d’une bataille victorieuse et décisive pour la France… Toute histoire a un autre versant. Le propre d’un empire, c’est de créer sa propre réalité. »
« Pour un peu de fraîcheur, il y a les mosquées et les centres commerciaux. Dieu me pardonne, mais j’avais besoin d’une chaise et d’être sûr de retrouver mes baskets à la sortie, il ne restait plus donc que les shopping centers »
« « Et si tu étais en train de sacrifier les meilleurs moments de ta vie – ta liberté – à suivre des règles inventées ? Et pour quoi ? Un paradis dont seraient exclus ceux qui n’ont pas reçu le plan d’accès en héritage ? »
Je me lève à mon tour, m’approche d’elle, feins de vouloir l’enlacer, me fais violence pour ne pas le faire.
« Et si c’était justement ça, la foi : faire quelque chose qu’on n’est pas certain de comprendre, croire à ce qu’on ne peut pas voir… Ce que tu appelles la foi, j’appelle ça l’amour. Pour moi, il n’y a de paradis que dans les moments que nous passons avec ceux que nous aimons. »
Elle frôle ma main du bout des doigts tandis qu’elle s’éloigne.
« Hein, dis-moi, my darling… Qu’est-ce que j’irais faire au paradis si tu n’y es pas ? » »
« Aussi, mais j’allais dire : toutes les histoires n’ont de valeur que pour ce qu’elles peuvent éveiller chez le prochain lecteur. C’est toujours la même histoire qu’on raconte, c’est toujours une nouvelle histoire qu’on entend. »