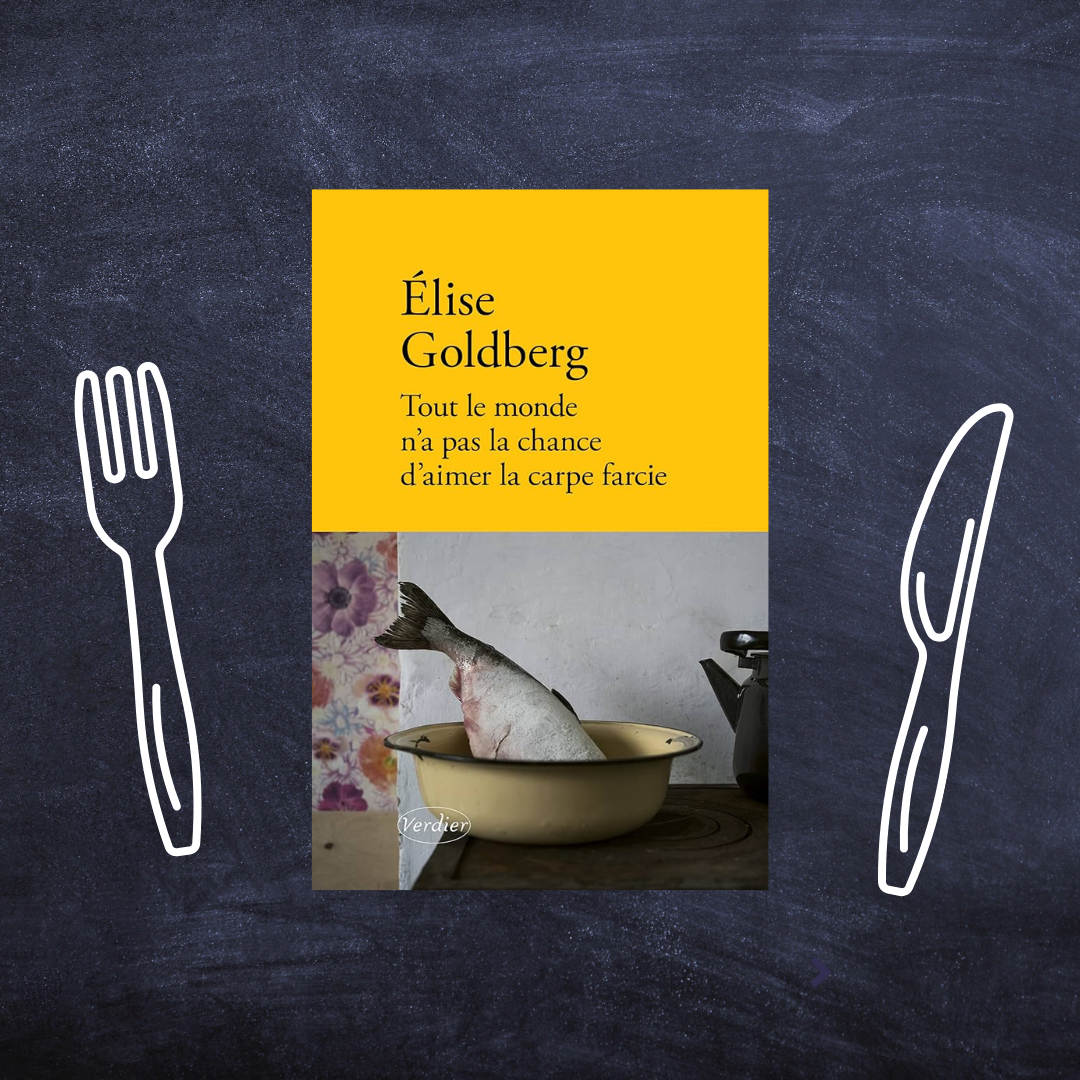Je débute cette rentrée littéraire d’hiver avec un auteur dont j’avais adoré son précédent roman, « Tant qu’il reste des îles ». J’attendais donc avec une certaine impatience et joie cette lecture.
« Tempo » est un roman aux accents autobiographiques, en tout cas j’ai ressenti beaucoup de sincérité et de justesse. Avec deux temporalités, l’auteur raconte l’histoire d’un trentenaire, musicien et jeune père de famille. Les chapitres alternent entre passé et présent. Le tempo est plutôt lent et nostalgique. On reste du point de vue du narrateur qui est le personnage principal.
Félix Pogram essaye de concilier carrière musicale et vie de famille. On sent des tensions régulièrement au sein du couple. Il n’arrive pas à jouer pour son fils. Un certain mystère plane autour du groupe de musique auquel il appartenait et qui a pris fin. Il tente d’effectuer une sorte de deuil de ce groupe. Il raconte la formation du groupe, les concerts, les déboires, l’osmose lors de la création de nouvelles chansons, sa relation avec les autres membres, notamment Louis.
Il est à un tournant de sa vie et il se pose des questions existentielles : faut-il abandonner la musique ? Son rêve de carrière de musicien ? Sa famille doit-elle passer avant tout ? On le suit dans ses réflexions et ses choix. On le voit devenir adulte. Les thèmes sont la musique, l’amitié, la paternité, les rêves.
Le roman est accompagné d’une playlist. Il est bourré de références musicales qui ont accompagné Martin Dumont, ancien membre du groupe Smatch. Je suis ravie de retrouver sa plume et sa sensibilité. Encore un magnifique roman publié par les éditions Les Avrils.
Merci Babelio et Les Avrils pour cette masse critique privilégiée
Incipit :
« Il n’y a pas d’applaudissements. Les conversations reprennent, je bois une gorgée de bière avant de me réaccorder. J’égraine doucement les cordes. »
« J’ai le fracas de la vie qui s’efforce d’être heureuse. »
« Qu’est-ce qu’il nous reste exactement une fois qu’on a laissé filer nos rêves ? »