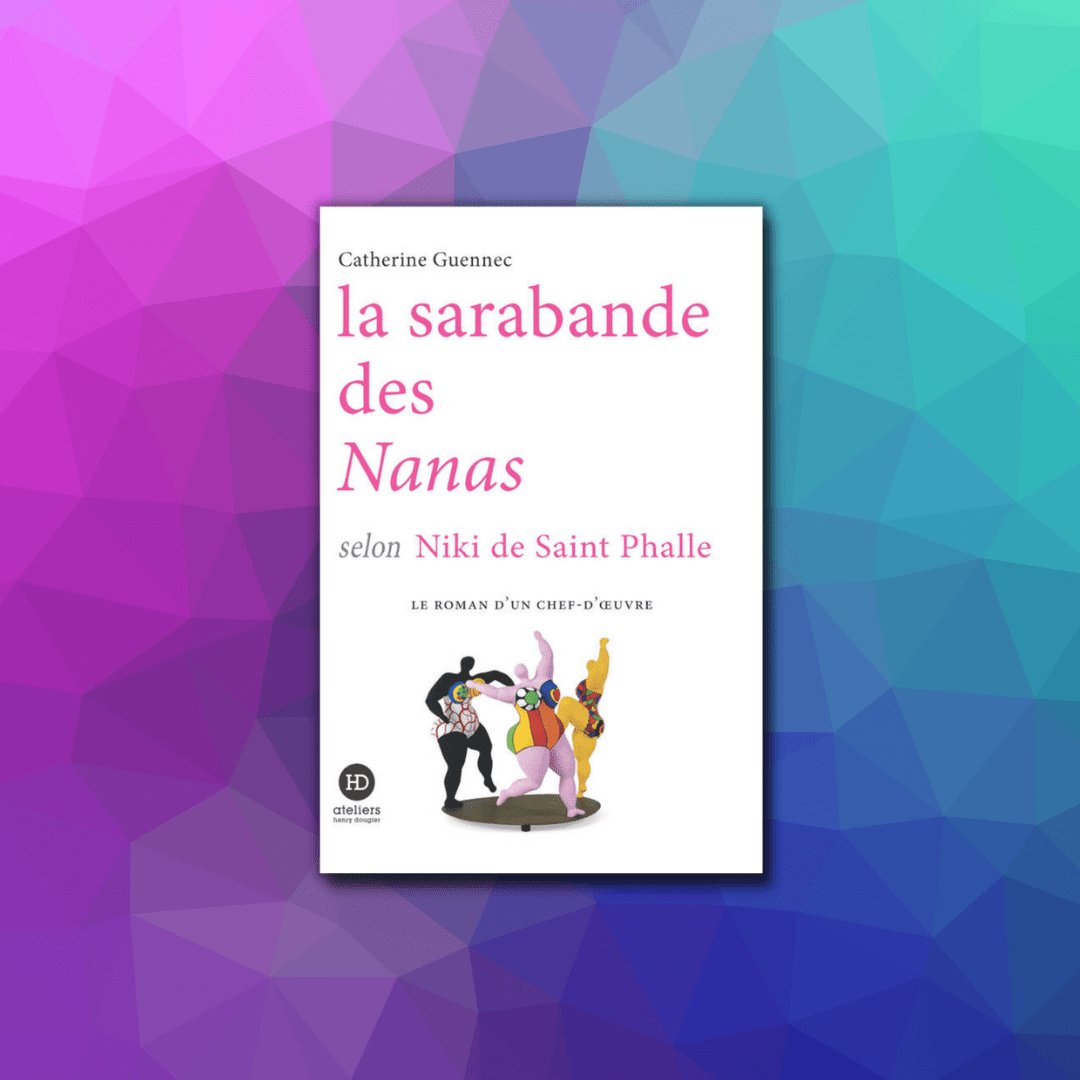Dans ce récit intime, Nathalie Ohana raconte ce moment où elle se rend au chevet de sa mère dans le coma. Après une réaction de déni devant l’évidence que sa mère va mourir, elle s’adresse et s’ouvre à elle. Elle raconte leur vie, son enfance, leur relation. Elle fait le portrait de sa mère mais aussi d’elle-même. Elle raconte des moments difficiles comme lorsqu’elle intègre une grande école et se rend compte qu’elle est différente des autres étudiants. Elle redouble d’efforts pour acquérir les savoirs qui semblent innés chez eux. Comme souvent, ce sont des rencontres avec des personnes clés qui lui permettront d’avancer.
Il y a de nombreux passages sur sa relation à la lecture, aux bibliothèques et à l’écriture qui raviront les amateurs. Ce livre est empli de poésie et de tendresse. L’écriture est douce et fluide. Nathalie Ohana nous ouvre son intimité en toute simplicité. On ne peut qu’être touché par cette relation mère-fille, cette famille qui déborde d’amour, certes parfois étouffant mais dont elle nous explicite les raisons au fur et à mesure des pages. Il est aussi question d’identité et de choc des cultures. Sa mère a quitté la Tunisie pour venir en France. Il y a notamment le moment où l’autrice découvre que sa famille est juive mais elle ne sait que faire de cette information. Elle n’a pas été initiée à cette religion.
Écrire est une sorte de thérapie. Elle livre ses doutes, ses interrogations, son cheminement intérieur. Ce n’est pas un livre triste, il n’y a pas de pathos mais beaucoup de sincérité et une très belle plume. Une fois commencé, vous aurez certainement envie de le lire d’une traite.
Je remercie l’autrice pour l’envoi de son livre.
Incipit :
J’ai ouvert la porte de ta chambre, je suis entrée comme pour éteindre un incendie. J’ai jeté mon sac à mes pieds et je me suis approchée de toi. J’ai gardé mon manteau sur le dos, car j’avais trop froid de te voir endormie. Froid de te voir enfermée dans un monde duquel j’étais exclue. D’habitude, il n’y a rien que tu ne partages pas avec moi. Tes pensées, tes espoirs, tes peurs, ton assiette, tout. »
« A pas de velours, je me suis approchée de toi, j’ai pris ta main, j’ai embrassé tes joues, mes lèvres ont reconnu leur creux et j’ai prononcé ce mot qui m’a paru soudain aussi fragile que moi : « Maman ». C’était comme si, pour la première fois, j’appelais mon nouveau-né du prénom que j’avais choisi pour lui. Maman. Ce mot, mon tout premier mot, disparaîtrait de ma bouche en même temps que toi. »
« J’étais enfant arrivée sur le tard, comme une dernière chance. Tu ne voulais pas que je me brûle à la flamme de la vie, trop chaude, trop dangereuse, trop intense. La flamme de la vie, toi, avec ta naïveté et ton optimisme d’antan, elle t’avait brûlée. Elle avait laissé sur ton corps des cicatrices indélébiles. Alors je m’en suis éloignée et ne l’ai utilisée que pour éclairer les pages des livres que je lisais. Tu préférais de loin que je me frotte à la douceur du papier. Enfant seule entourée d’adultes qui ne me racontaient pas la vraie vie, il ne me restait que les textes des autres pour savoir ce que tu me cachais. Dans notre bibliothèque, tu avais sélectionné des romans à l’eau de rose et il me fallut attendre un certain temps avant de tomber sur les livres qui font mal. Un jour, je suis rentrée de l’école avec le livre Un sac de billes et, tout en me servant ton pot-au-feu, tu as médit sur le professeur qui apportait de la tristesse à notre table. »
« Avant celle des livres, ma grande découverte fut celle des mots. »
« Aller à la bibliothèque me remplissait, les nourritures que j’y trouvais me tenaient au ventre pendant plusieurs jours. »
« Lire des pages sans images permettait à mon imaginaire de se charger de l’illustration. Les mots étaient ceux de tous, mais les images qui se formaient dans ma tête n’étaient qu’à moi. Ces images étaient le fruit de mon histoire, j’y retrouvais des sensations, je revoyais des visages croisés ou inventés. Enfin, la récréation ne me torturait plus, je pouvais retrouver en cachette celle qui, alors, devint ma meilleure amie : ma solitude. Ma corde à sauter restait rangée dans mon cartable, au cas où la bibliothèque serait fermée mais, le plus souvent, les sauts que je faisais étaient d’époque, de narration, ou de style. Papa avait habitué mon palais au sucre des bonbons qu’il m’achetait en cachette de toi mais, là-bas, je salivais à la simple lecture des titres. La solitude que je voulais fuir était en réalité une porte ouverte vers de nouvelles rencontres ; j’étais libérée. Tourner les pages, c’était comme entendre le bruit du sucre qui éclate en bouche. Les corner, c’était sentir l’affolement des papilles quand le liquide acide envahit le palais. Je ne ramenais rien chez nous, je voulais tout consommer sur place, comme si l’atmosphère studieuse de ce lieu ajoutait au plaisir de lire. J’avais les dents bleues et la langue verte à force d’écouter ces inconnus murmurer à mon oreille des histoires inédites. Je pensais à chaque fois leur arracher des confidences, mais c’était en réalité la cloche de la sonnerie qui m’arrachait à eux. Le soir, mon cartable était léger comme une plume, mais mon cœur était rempli. Je sautillais dans la rue en me disant, ma nouvelle famille, c’est eux. »
« Je ne suis pas allée vers les livres pour me mettre à distance de toi. Je suis allée vers eux comme je serais entrée dans une salle pleine de têtes inconnues. Avec tant de rencontres à faire, tant d’histoires à écouter. Les livres sont venus remplir mon vide, ils ont tenu compagnie à ma solitude d’enfant. J’ai trouvé en eux les sœurs que je n’ai jamais eues, les confidents sont j’ai souvent manqué. Les livres m’ont rassurée en me disant que je n’étais pas folle, ils ont créé un lieu pour que mon excentricité s’exprime, ils ont été les fondations de ma nouvelle maison. Aujourd’hui encore, j’appréhende une nouvelle rencontre comme un livre. Je suis encore pressée de tout. Je balaye les épisodes de vie comme les pages, je feuillette jusqu’au chapitre qui m’intéresse et, ensuite, je le dévore. Si la rencontre m’a marquée comme le texte, j’y pense sans cesse et quelque chose se dépose en moi pour toujours. Sinon, j’oublie la rencontre comme le livre que je crois ne jamais avoir lu. »
« Je me sentais étrangère dans mon propre pays de naissance. Le passeport que je présentais, c’était celui de tes blessures. Et celles ne cessèrent de s’étendre à mesure que les jours à l’écart de leurs fumées s’écoulaient. Mon nom de famille à consonance arabe avait beau avoir une sonorité élégante, presque française, il n’empêche que je me sentais d’emblée suspecte. Tout me heurtait ; leurs chaussures trop vernies, leurs sourires de connivence, leur aisance à l’oral, les livres qu’ils avaient lus en primaire, les expositions qu’ils avaient aimées. Tout. »
« A présent, l’angoisse a changé de rive, elle est de mon côté et, toi, tu affiches l’indifférence qui était la mienne à tout ce qui pouvait advenir. »
« Sans l’éveil au monde, on reste touriste de notre propre vie. »
« J’ai été l’enfant qui gomme, qui comble, qui répare, qui rattrape. »
« Je sautais à l’élastique dans la cour de l’école primaire quand une camarade du cours préparatoire m’avait approchée avec cette question si bizarre : « Tu es quoi, toi ? » L’élastique s’était affaissé à mes pieds, j’avais froncé les sourcils et, voyant que je ne comprenais pas la question, elle avait détaillé quatre réponses possibles : « Tu peux être catholique, musulmane, juive ou rien. » J’avais tenté de retenir ces mots compliqués en lui promettant une réponse pour le lendemain. Le soir, en sortant les endives au jambon et au fromage du four, tu ne m’avais même pas regardée en me répondant : « Dis-lui que tu es juive. » Sans ajouter le moindre élément de contexte, tu m’avais laissée explorer seule ce que cette phrase avait de conséquences. »
« Pour toi, écrire, c’était être impudique. C’était entrer sans frapper dans toutes nos zones de honte. C’était vouloir éclairer ce qui ne demandait qu’à sombrer dans l’oubli. C’était dérouler le tapis au milieu du couloir, à la vue de tous, sur lesquels des inconnus s’essuieraient les pieds. »
« Faire un métier artistique, monter sur scène, c’était plonger à pieds joints dans tes peurs. C’était reprendre le bateau, revivre le temps de l’indépendance en Tunisie, revoir les encriers jetés par terre et revivre l’errance, matérielle cette fois-ci. C’était à nouveau travailler à l’heure comme caissière au magasin général de ta tante à Tunis, c’était revivre l’humiliation familiale, sociale, avoir une vie décousue et, surtout, c’était s’aventurer sur un territoire qui n’était pas le nôtre. »
« Au moment où je t’ai dit que tu ne m’avais jamais empêchée de rien, tu as serré ma main en retour. Tu ne m’as jamais empêchée de rien mais, pendant toutes ces années, j’ai pris la décision de ne pas danser avec tes peurs. »
« Chaque nuit, immergée dans le noir, les mots se sont mis à couler en flot continu, comme le barrage qui cède après des années de retenue. Ils se sont épanchés sur le papier, comme les gouttes de sang de ta veine éclatée, dont personne ne se doutait. Tant qu’ils coulaient, à flux constant, je me sentais vivante, ton cœur battait de plus belle. Dans leur course lente mais certaine, ils m’ont appris la patience et la frustration que tu n’as jamais osé m’enseigner. »