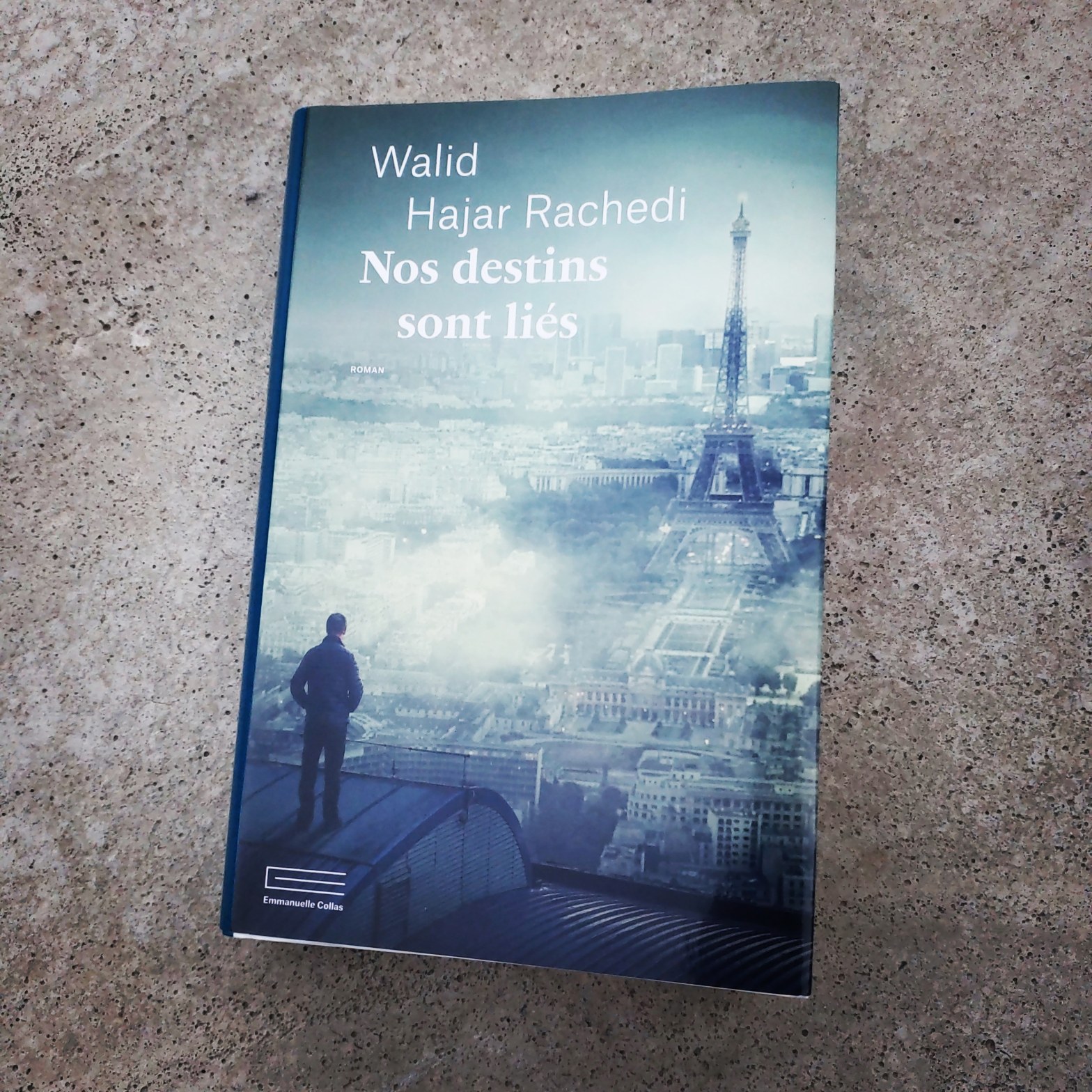Pour ma dernière case du challenge de l’été VLEEL, j’ai lu un roman adapté au cinéma. Ceux qui me connaissent, savent que je vais rarement au cinéma. Cette catégorie n’a pas été évidente pour moi, c’est pour cela qu’elle arrive en dernier, sur fil, le dernier jour du challenge !
Ce roman est paru en 2017 et son film est sorti début 2023.
Le narrateur se souvient de ses années au lycée et plus particulièrement l’année 1984, celle de ses 17 ans où son corps a rencontré celui de Thomas. Un événement dont il a rêvé mais qu’il pensait inaccessible car autour du beau Thomas gravitent beaucoup de filles. C’est Thomas qui prend l’initiative et lui donne rendez-vous loin du regard des autres. Personne ne doit s’avoir qu’il aime les garçons.
Le narrateur est fils d’instituteur. On sent la différence de classe sociale entre les deux jeunes hommes. La famille de Thomas est agricultrice. Au fur et à mesure de leurs rendez-vous cachés, chacun révèle des parts intimes, parle de sa famille. Sont-ils si différents l’un de l’autre ? Leur avenir est-il tout tracé ?
Dans ce roman autobiographique on découvre l’auteur naissant, celui qui invente déjà, imagine. En 3 parties de longueurs inégales, Philippe raconte d’abord sa passion amoureuse pour Thomas, puis la rencontre fortuite du fils de Thomas 20 ans plus tard et enfin une ultime rencontre avec le fils qui lui remet une lettre de Thomas.
Il parle librement, sans tabou, parfois de façon crue, toujours avec justesse et sensibilité. Il y a des passages très émouvants. Il retranscrit très bien les premiers émois, le désir de ces adolescents.
Ce roman a reçu le Prix Maison de la Presse en 2017 et a été finaliste du Prix Orange du Livre 2017.
Incipit :
« C’est la cour de récréation d’un lycée, une cour goudronnée cernée de bâtiments anciens aux fenêtres larges et hautes, à la pierre grise. »
« J’ai dix-sept ans.
Je ne sais pas que je n’aurai plus jamais dix-sept ans, je ne sais pas que la jeunesse, ça ne dure pas, que ça n’est qu’un instant, que ça disparaît et quand on s’en rend compte il est trop tard, c’est fini, elle s’est volatilisée, on l’a perdue, certains autour de moi le pressentent et le disent pourtant, les adultes le répètent, mais je ne les écoute pas, leurs paroles roulent sur moi, ne s’accrochent pas, de l’eau sur les plumes d’un canard, je suis un idiot, un idiot insouciant. »
« La mort de beaucoup de mes amis, dans le plus jeune âge, aggravera ce travers, cette douleur. Leur disparition prématurée me plongera dans des abîmes de chagrin et de perplexité. Je devrai apprendre à leur survivre. Et l’écriture peut être un bon moyen pour survivre. Et pour ne pas oublier les disparus. Pour continuer le dialogue avec eux. Mais le manque prend probablement sa source dans cette première défection, dans une imbécile brûlure amoureuse. »
« Je me demande si la froideur des pères fait l’extrême sensibilité des fils. »
« Tout de même, je me suis demandé si cela pouvait être une invention. Vous savez maintenant que j’inventais tout le temps et j’y mettais tant de vraisemblance qu’on finissait par me croire (il m’arrivait moi-même de ne plus être capable de démêler le vrai du faux). Plus tard, j’en ai fait un métier, je suis devenu romancier. Cette histoire, est-ce que que j’aurais pu la fabriquer de toutes pièces ? Est-ce que j’ai pu transformer une obsession érotique en passion ? Oui, c’est possible. »
« On ne se défait jamais de son enfance. Surtout quand elle a été heureuse. »
« Il dit : vous avez dû l’aimer beaucoup, pour me regarder comme ça. »