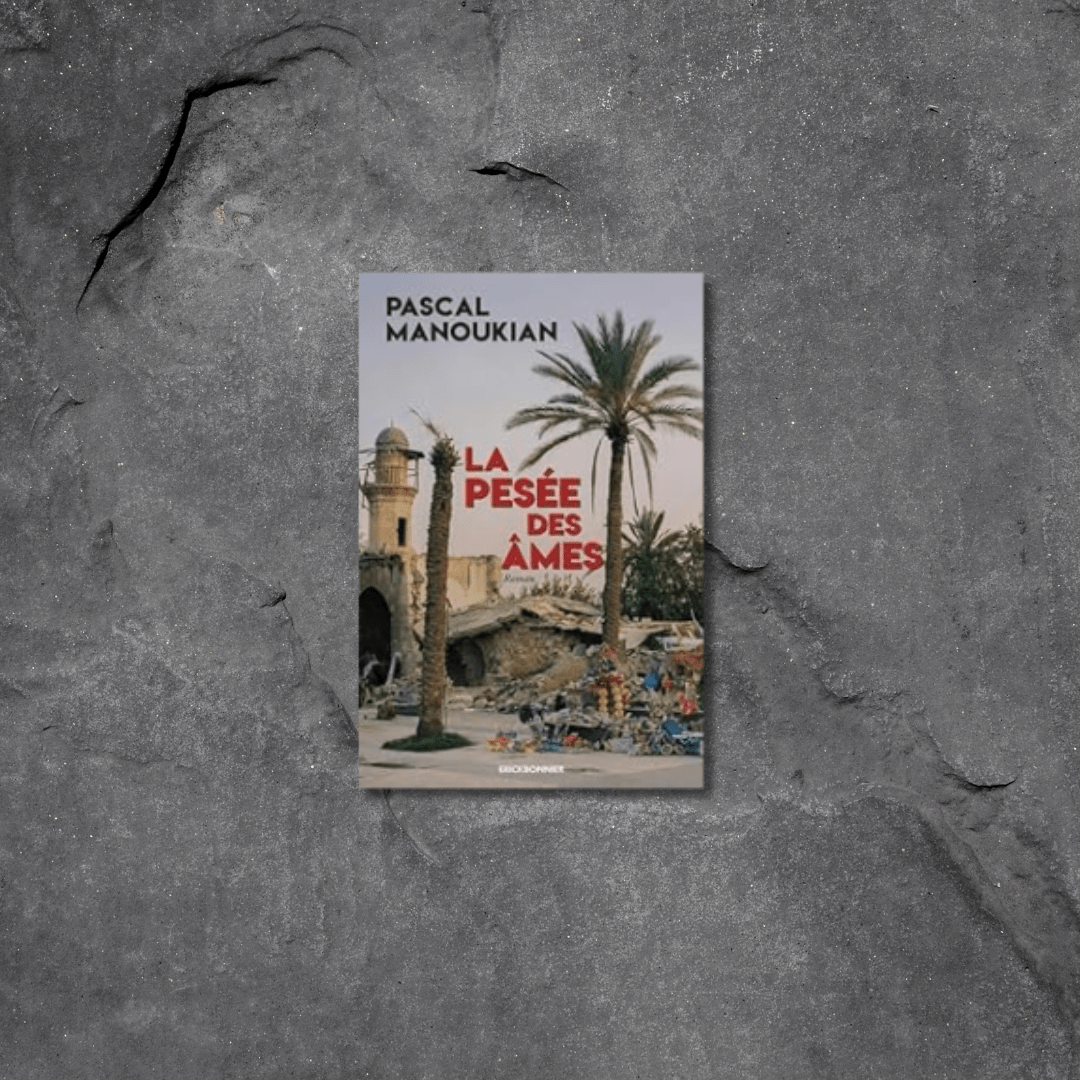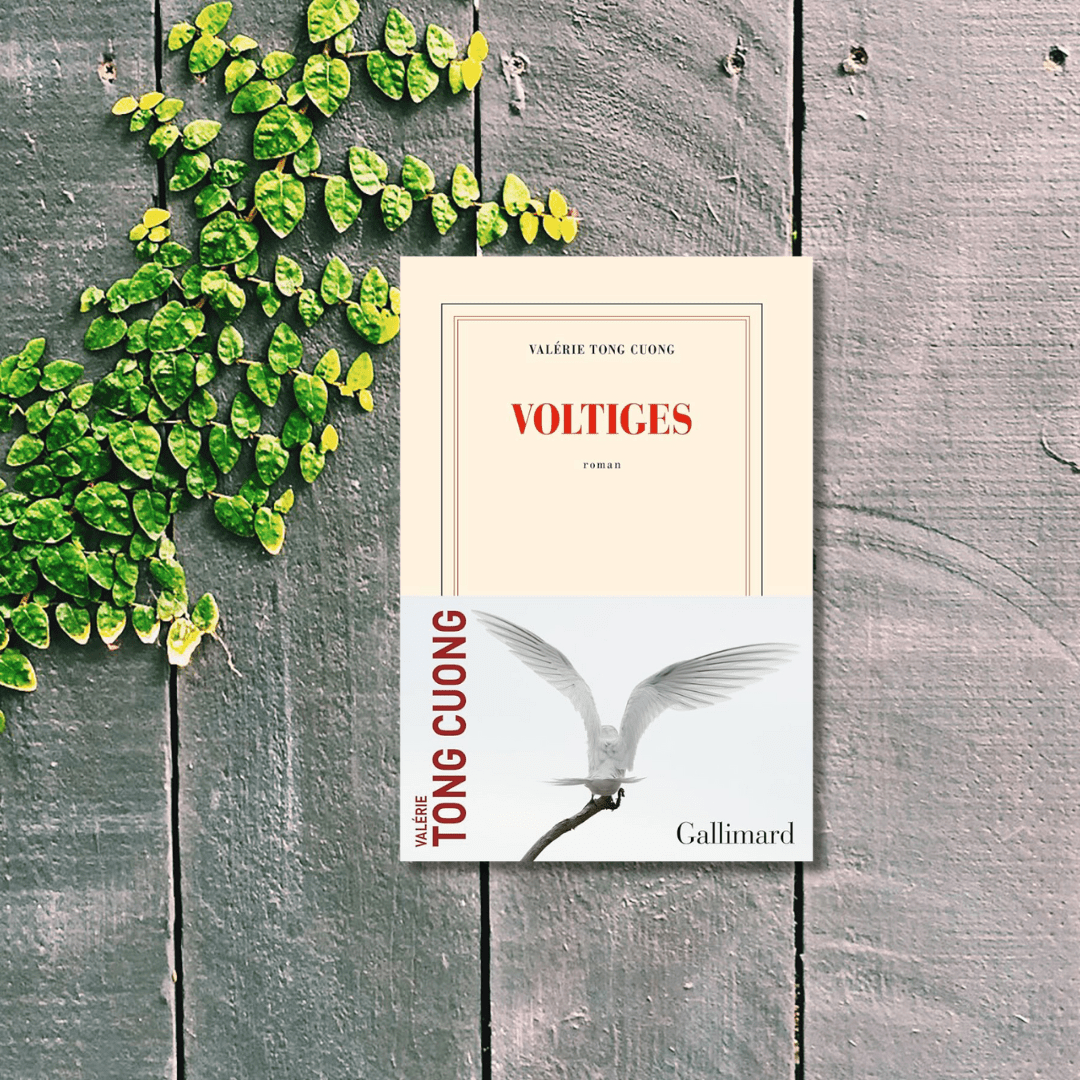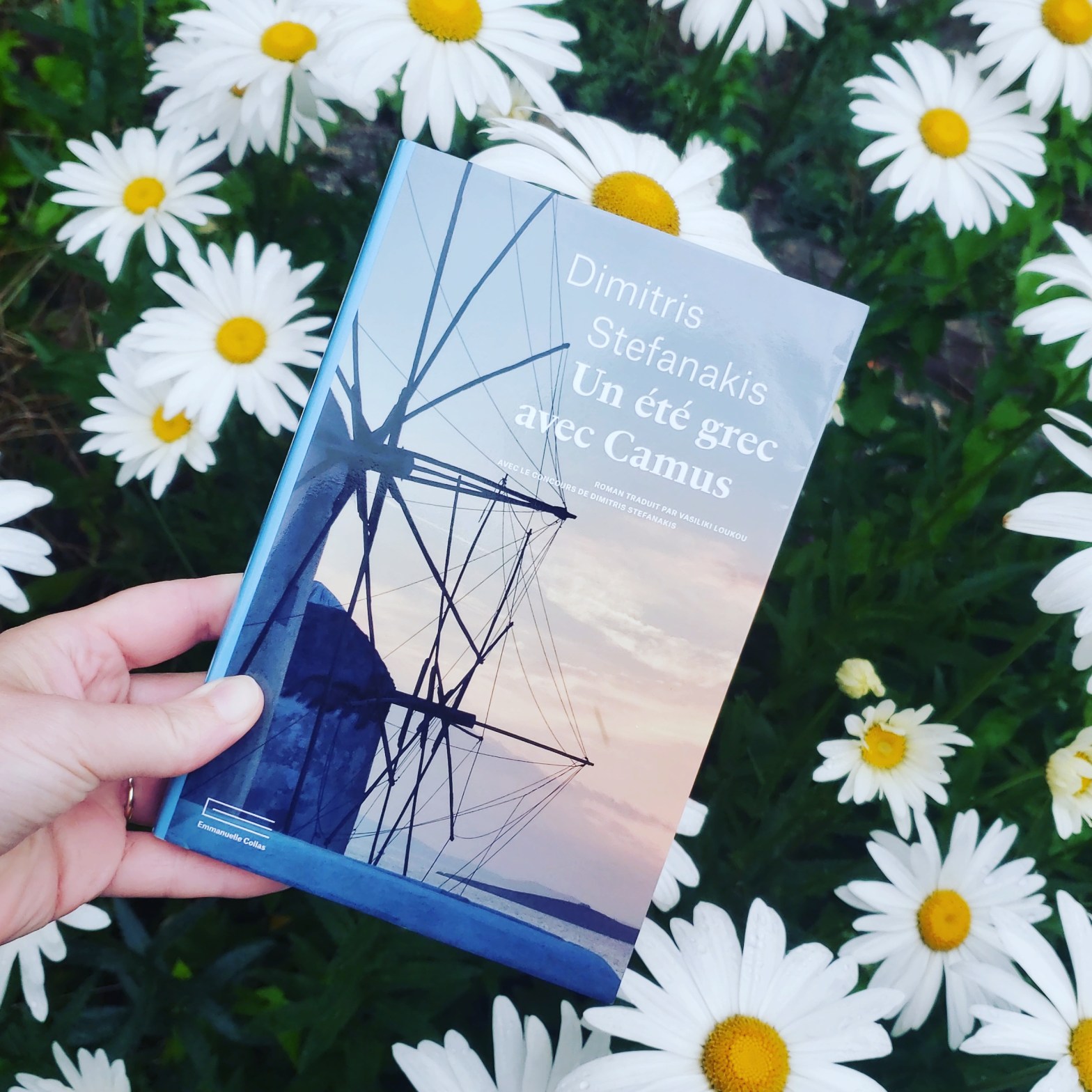2016, Ernest Bollard, jeune reporter de guerre pour une chaîne de télévision française, comme feu son père, s’apprête à repartir en Syrie. Il ne vit que pour ces moments d’adrénaline, caméra au poing. Est-ce du courage ou l’inconscience ? Ou une façon de fuir ?
Son amoureuse, Louise, n’en peut plus de ces départs répétés et du danger vers lequel il fonce. La mère d’Ernest perd la tête et la notion du temps. Elle vit dans le passé. Ils relisent les carnets laissés par le père d’Ernest.
La chaîne Horizon vient d’être rachetée par l’homme d’affaire Victor Bellonne. La rédaction déchante vite. Des changements que les journalistes n’approuvent pas du tout se profilent. La rentabilité et l’argent sont les moteurs de ce nouvel actionnaire du média.
Le roman alterne entre Paris et Alep assiégée. Qui dit guerre dit bombes, ruines, morts, impossibilité de se soigner. Mais il y a aussi de l’entraide et de la résistance. Pascal Manoukian nous offre de beaux portraits de personnages syriens, singuliers et attachants.
On tremble pour la vie d’Ernest. On enrage avec les décisions de Bellonne dont seuls ses intérêts personnels le préoccupent. Le titre est très beau et poétique. L’écriture est magnifique. Un roman au cœur de l’actualité, qui nous questionne sur la lâcheté, celle des politiques mais aussi la nôtre.
Je remercie l’auteur pour cette très belle lecture.
Incipit :
« La télévision, éclabousse la chambre de reflets bleus. Sur l’écran, défile le malheur pixelisé d’une ville aux enfers. Alep pèse ses âmes. Au milieu des ruines, voilée de sombre, une ombre serre un petit corps, artificiellement secoué par ses sanglots. »
« Aujourd’hui, il ne reste rien, ni des fastes de l’hôtel, ni de ceux d’Alep, ni de l’éternelle Syrie : plus d’eau, plus d’électricité, plus de bois pour se chauffer, plus d’hôpitaux, plus de visiteurs, plus d’écoles, plus d’échoppes ni de souk. Rien, juste une immense dentelle de ruines, jetées sur la ville comme un sort ou plutôt comme un linceul. Un amas d’absurdité avec, au-dessus, et sous les gravats, des milliers de vies estropiées par cinq terribles années de guerre.
Une longue cicatrice partage désormais la ville d’ouest en est. Une plaie ouverte, aux berges encore mouvantes, incertaines, changeantes de jour en jour. Côté couchant, l’armée de Bachar el-Assad, héritier du pouvoir de son père, président à poigne d’une Syrie un moment ébranlée par les secousses des Printemps arabes, sauvée in extremis de la déroute par l’aviation d’un autre fossoyeur de la démocratie, russe celui-là. Côté Levant, le camp dit des rebelles, un mezzé d’insurgés et d’indignés, un nuancier de toutes les révoltes, frustrations et utopies, allant du noir ténèbres des hommes de Daesh, au vert espoir des déserteurs de l’armée syrienne, rebaptisée libre, par opposition à celle encore fidèle au pouvoir. Un cimetière à ciel ouvert où le régime, pour survivre, avec l’aide de l’aviation de Poutine, a enterré vivantes les aspirations de justice et d’équité de milliers de Syriens. »
« Je me demande comment je fais pour poser encore un pied devant l’autre. Les cols sont aussi rudes que les hommes. Je profite de chaque pas pour réfléchir et comprendre ce que j’ai vécu, j’essaye de faire le tri entre ce qui tient de mes émois et ce qui est de l’ordre de l’information. Il me faut ce sas pour démêler les faits de mes impressions. Et puis j’ai passé tellement de temps seul avec les Afghans que j’ai besoin de cette lenteur pour revenir à vous. »
Aujourd’hui, regrette Ernest, l’émotion l’emporte sur tout. L’immédiateté étouffe la réflexion à la vitesse des réseaux. Presque rien ne distingue le vrai du faux, Internet rend toutes les frontières poreuses. L’étanchéité entre la vie privée et la vie professionnelle prend l’eau. N’importe où, il n’est plus jamais seul. Quel que soit l’enfer où il débarque, il traîne au bout de sa 4G un rédacteur en chef, un banquier, Louise quand elle ne boude pas. Chacun lui réclame tout et son contraire, plus d’efficacité, plus de prudence ou de baisers, déconne, pleure, le sermonne. Chaque connexion brouille un peu ses choix, l’extrait du drame où il est venu s’immerger pour le comprendre.
A chaque relecture des carnets de son père, il désespère de ce que devient son métier. Plus le monde se complique, plus on lui demande de le simplifier. Il faut enquêter, voyager, filmer, monter, commenter et diffuser, toujours plus vite. Il aimerait retrouver un peu de lenteur. Il lui semble ne jamais faire assez, n’être que de passage, à la fois dedans et dehors, en mauvais équilibre. »
« Il sait les destructions invisibles des armes sur les âmes. Comme toujours, une fois le dernier mort enterré, il sera plus facile de rétablir l’eau et l’électricité que la fraternité et l’espoir. »
« Je suis sérieuse. Je me suis habituée à ces peurs-là. Elles me rassurent. Les autres, celles qu’il faudrait que j’affronte pour partir d’ici me tétanisent. Les convois, les passeurs, les embarcations de misère, l’eau de la mer dans mes poumons, les cimetières par cent mètres de fond, la crasse des camps, ne pas avoir d’autres horizons que des tentes, tous ces noms de villes dont je n’imagine que la poussière et la désolation, non, sincèrement, je n’ai pas ce courage-là. En fait, il faut être un peu lâche pour rester ici. Ce sont les plus courageux qui partent, les plus entreprenants, ils risquent tout, leur vie, celle de leurs enfants, leur argent. Je ne comprends pas que vous puissiez les refouler à vos frontières. Ce sont les meilleurs d’entre nous. »
Nazélie
« Pour sauver mon âme » a-t-il expliqué plus tard.
Elle se lève plier ses affaires.
– C’est pour sauver la mienne que je repars. C’est l’heure de la pesée des âmes Ernest.
Elle tend les deux mains à plat devant lui.
– Le jour du jugement dernier, dans la tourmente de l’enfer, l’Archange St Michel, place les âmes sur les plateaux de sa balance. Chaque courage, chaque lâcheté, les fait pencher dans un sens ou dans l’autre.
Elle s’amuse à faire monter et descendre ses paumes.
– L’âme du juste, plus légère, est séparée de celle du mauvais. Aux uns les tourments, aux autres la paix. C’est à ce moment seulement que l’on sait réellement qui a gagné, et qui a perdu.