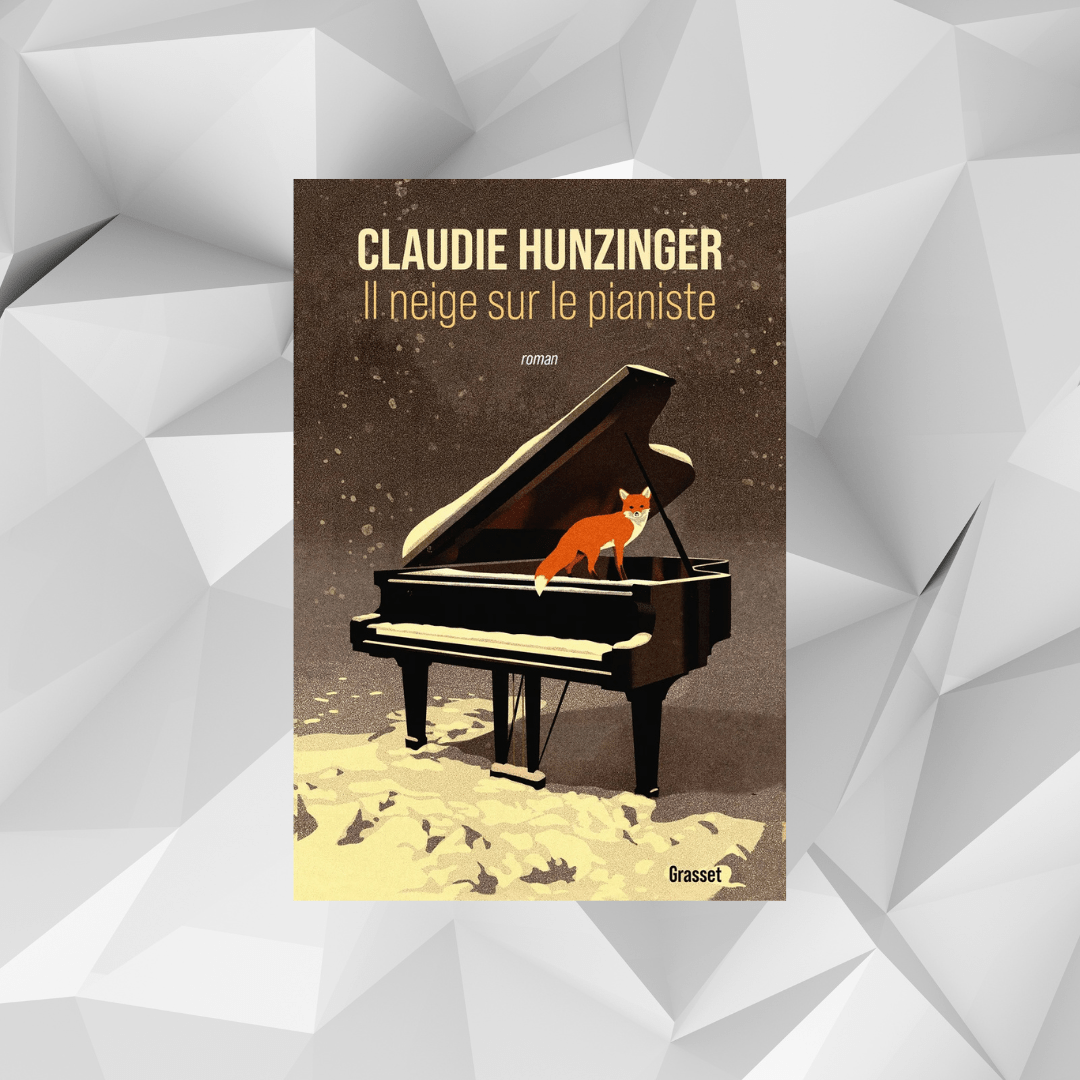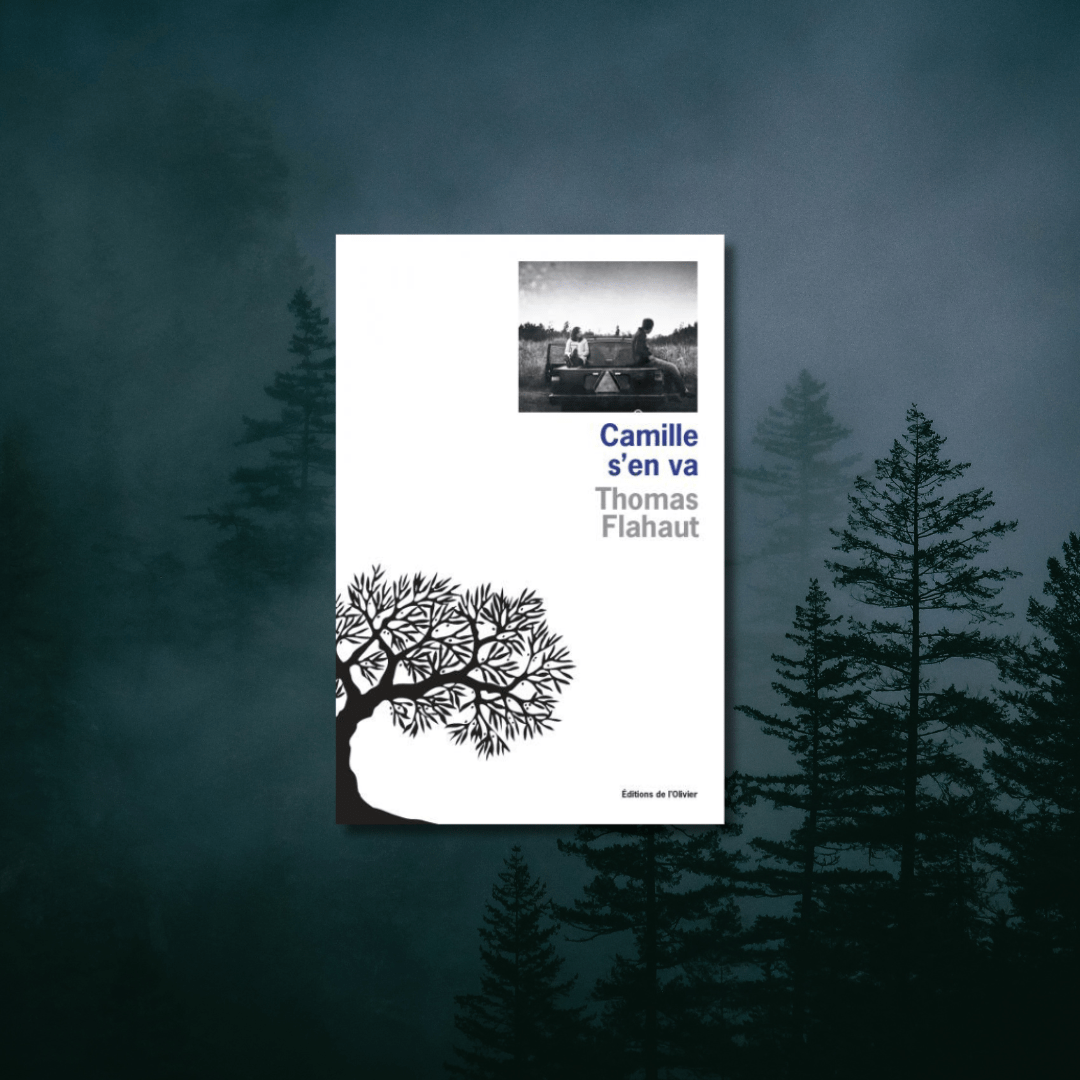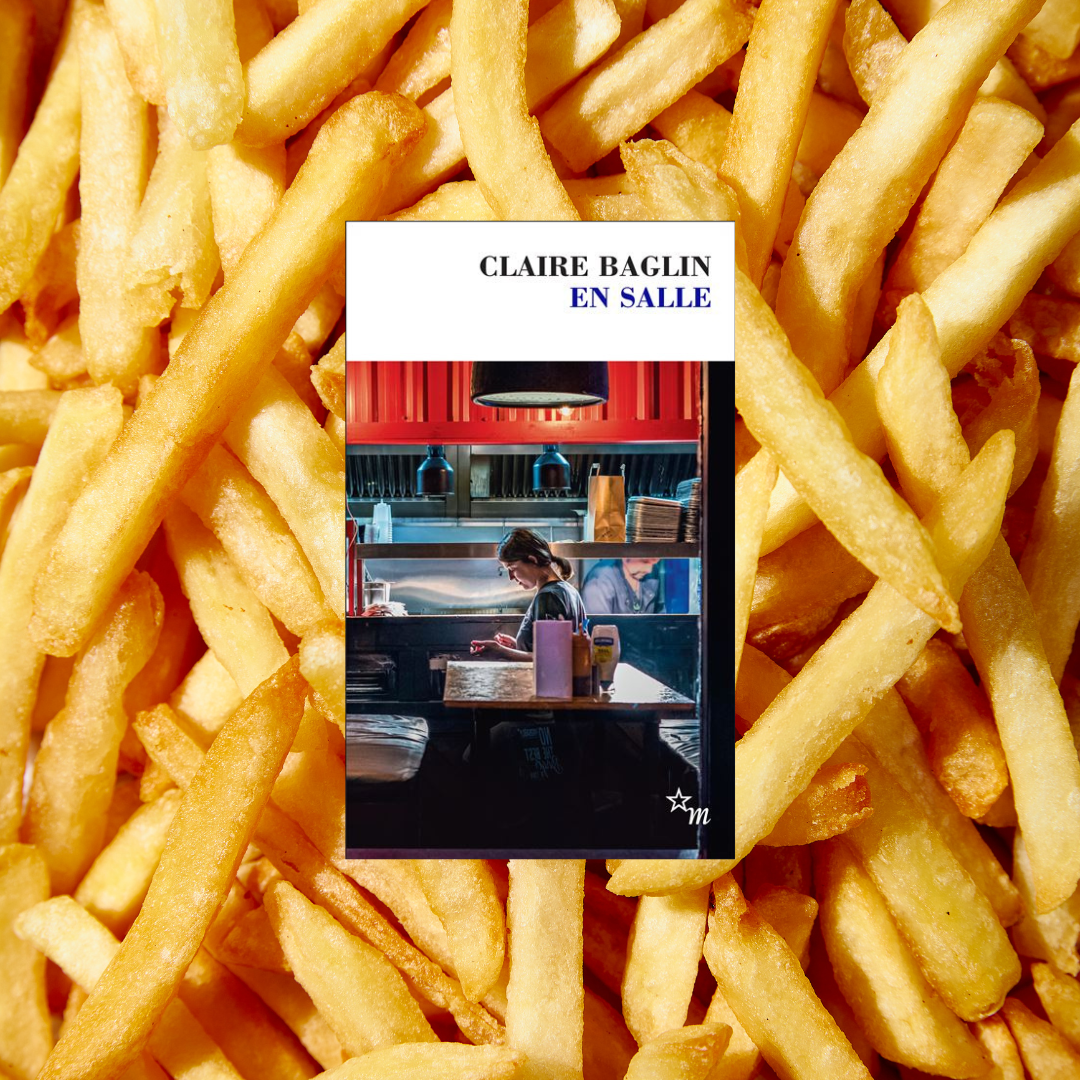Dans ce nouveau roman, on retrouve l’univers de l’autrice. Elle vit dans une maison au milieu de la nature. Elle nourrit un renard tous les soirs. Elle s’émerveille de pouvoir observer cet animal. Elle écrit sur les sons. Les onomatopées sont très présentes. Il y a par exemple les différents sons produits par la neige à différents états. Elle nomme les émotions provoquées par la musique, très présente également.
Et puis un jour, un pianiste renommé répond à son invitation et séjourne chez elle. La neige le contraint à rester plus longtemps que prévu. Une ambiance étrange s’installe, une sorte de huis clos. Elle éprouve un sentiment amoureux mais elle ne sait pas si c’est pour ce musicien, plus jeune qu’elle, ou pour le renard. Elle nous livre ses pensées, sa sensibilité de femme. Elle est intimement liée à la nature. Elle évoque aussi la vieillesse et la solitude.
J’aime la façon dont elle parle de la nature, et de bien d’autres sujets d’ailleurs, sa poésie aussi. Mais j’avoue avoir préféré son précédent livre à celui-ci. Je ne suis pas totalement entrée dans l’histoire. Et vous, l’avez-vous lu ?
Incipit :
« Je guettais le léger bruit à l’étage, n’y croyais pas, n’en revenais pas, et soudain, une joie foudroyante : je l’ai capturée, oh ! je l’ai capturé, il est ici, et la neige dans la nuit continue à tomber, chtt chtt chtt. Demain, son épaisseur sera parfaite. Il ne pourra pas repartir. Je vais le retenir. Le garder. Je vais le séquestrer. »
« J’avais répondu : « Pour que vous arriviez jusqu’ici, il faudrait que vous vous soyez d’abord perdu dans la neige, longuement, avant de trouver la maison. » Je m’étais beaucoup avancée, la neige n’était-elle pas comme les ourses blanches et les sternes néréis en voie critique d’extinction ? Alors pourquoi avoir parlé de neige ? Pour provoquer le hasard, hypersensible, avec ce mot qui vous frôle ? »
« J’ignorais encore que le musicien venait également de tomber dans le cercle magique annoncé quelques minutes plus tôt par le renard, qu’il s’agirait d’un bizarre roman d’amour, qu’il en serait le personnage, et qu’avec le renard ça m’en ferait deux, et que jusqu’à la fin je ne saurais pas lequel des deux j’allais aimer le plus. »
« Cela faisait quatre ans que je vivais dans cette maison située au cœur d’un massif escarpé, difficile d’accès, sauvage, abritant une tourbière, des salamandres, des cerfs, une place de brame, un chat sauvage, des pics noirs, des milans royaux. Or voilà que du matin au soir, la forêt hurlait, tel l’écho d’autres forêts. Tourbillons de membres, multitude de chevelures vertes, fragments de pieds, de mains, corps odorants, dénudés, dépecés, tirés, rangés, entassés, prêts à être livrés. Bûcherons qui travaillent, casque, lunettes, bottes à bout d’acier. Gros camions qui, la nuit venue, emportent leur chargement de grumes. Boue, ornières, odeur de gazole. J’allais alors toucher les troncs des résineux martelés encore debout, drus, parfumés. Leurs derniers beaux jours. Les miens aussi. »
« A vivre depuis si longtemps en compagnie des éléments, je sais qu’ils sont des systèmes habités d’une énergie qui nous échappe. La société, elle, commence seulement à le soupçonner, se demandant si les tornades, les canicules, les algues toxiques, les virus, les cachalots ne sont pas devenus des entités vengeresses. Les scientifiques leur répondent qu’il faudrait plutôt y voir des formes d’insubordination de masse. Une façon de se rebeller contre nous. »
« Plus tard, le musicien me dirait qu’une Bagatelle de Béla Bartók peut se révéler aussi puissante qu’une grenade, quelque chose de dur, de serré, de très dense, prêt à tout exploser de sa beauté. »
« Cinq minutes plus tard, au-dessus de ma tête, pour la première fois, le Steinway a résonné dans la maison, et les onomatopées, j’aurais pu en ramasser comme des grêlons. Il en pleuvait. Je ne pourrais pas dire qu’il s’agissait de musique. D’abord un orage. Puis, on aurait dit deux fouines se disputant un territoire. C’était hargneux et répétitif. Un combat de griffes et de gueules. Ça a duré trois à quatre heures à la file. Il n’avait pas dit quelle partition il avait apportée, et je n’aurais pas su dire à quelle partition il travaillait. C’était horrible. Il m’avait prévenue, la veille, assez sèchement : On peut se parler, discuter, mais j’ai un problème à être observé quand je travaille le piano. C’est quelque chose de très intime. Parfois de très sale. Ce n’est pas quelque chose qui se partage de façon naturelle.
Manifestement, c’était très intime. Il ne jouait pas, il se battait. Dommage de ne pas avoir le droit de suivre la bataille, le mouvement de ses pattes, le jeu de ses dents, leur toucher délicat, aigu, leur morsure mordant dent à dent les touches d’ivoire qui giclent. »
« Délicatement, il avale tout.
Combien de fois est-il déjà venu ? Pas une seule fin de journée, il n’a manqué de venir. Et chaque fois, je lui ai présenté un autre nouveau festin. C’est répétitif, ordonné comme une horloge, un rite, et sûrement la fonction des rites est-elle de remettre un peu d’ordre dans le chaos du monde.
Comme il est beau. Personne encore ne l’a tué. »
« Un jour, lors d’un entretien auquel j’assistais, un philosophe avait affirmé que les animaux n’ont pas conscience de la beauté. Que c’est ce qui nous différencie d’eux. J’avais pensé, ce n’est en aucun cas une supériorité de notre part, plutôt une infériorité, les animaux n’ont pas à avoir conscience de la beauté : ils sont la beauté. Et puis, la conscience, qu’est-ce que c’est la conscience ? Notre mauvaise conscience plutôt, non ? Notre fameuse dissonance cognitive, notre impossible innocence dans un monde mauvais. Non ? »
« Des amours, j’en ai deux. Un du jour, un de la nuit. L’un venu du dehors, m’apportant sa vie concrète, terrestre et menacée. L’autre, on dirait, venue de derrière la mort, m’assurant que tout a déjà eu lieu. Les horreurs ont été lavées à grande eau. Le monde resplendit. »
« Les renards, on le sait, sont des êtres narcissiques comme tous les écrivains. »
« Il faut comprendre que ma rencontre avec le renard est sans doute ce qui aura surgi de plus enchanteur dans notre monde sur le point de disparaître. Chaque soir, quelque chose d’extraordinaire se montrait. Il faudrait n’avoir jamais vu un renard de sa vie pour ne pas y reconnaître un prodige. Et ce n’était jamais sûr. Cela pouvait ne plus advenir. Cesser. Aussi, je ne me lassais pas du surgissement de sa beauté et j’attendais ce moment, j’y pensais toute la journée comme à une fête qui ne m’était pas due. C’était offert. Et à l’offert, chaque soir, je rendais son offrande. »