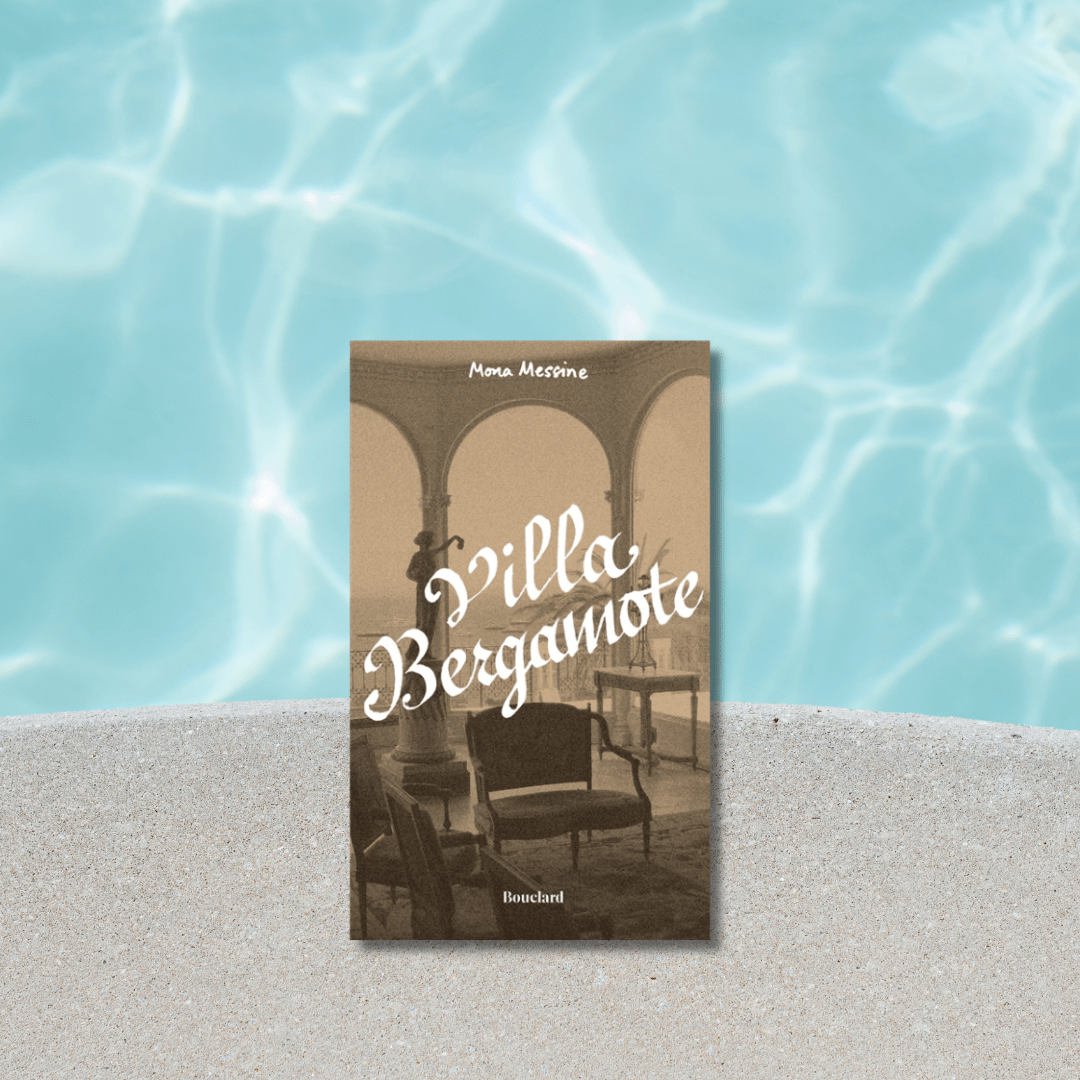Lendemain de pendaison de crémaillère chez les Godart, un couple de psychothérapeute et psychanalyste. Jean-Luc Godart a écrit un livre, exposé dans son salon, « Les emmerdes ne volent pas toujours en escadrille. » Maxime qu’il va pouvoir vivre avec plus ou moins de philosophie et de patience.
Alors qu’ils émergent, avec peu de souvenirs de leur soirée, quelqu’un sonne à la porte. C’est un plombier appelé en urgence pour déboucher leurs toilettes qui ne sont pas bouchées. Jean-Luc ne l’a pas appelé. C’est à n’y rien comprendre.
Les péripéties s’enchainent avec de nombreuses livraisons de choses invraisemblables, payées avec la carte de JL (pour les intimes). Emmaüs vient emporter des meubles. L’extérieur envahit l’intérieur, encombre l’espace intime, déclenche des scènes conjugales.
On se demande bien comment va se terminer cette histoire. Mais tout le suspense réside dans cette tartine collée au plafond. Va-t-elle tomber ? Si oui, de quel côté ? Et surtout comment tient-elle ? Anna répond à cette question par une autre : « Comment on fait tous pour tenir ? »
L’auteur interpelle les lecteurs au début du roman. Il dresse la scène d’ouverture avec les personnages et les décors. Il nous conseille d’imaginer des gens qu’on n’aime pas, « ce serait dommage de passer à côté du plaisir coupable délicieusement cathartique de voir des gens qu’on n’aime pas en baver, Non ? Si. Assumons, assumons. » Il insère avec malice les titres de ses précédents romans qui se font écho.
En lisant, je me suis tout de suite dit que je le verrai bien adapté au théâtre. D’ailleurs lors de la rencontre VLEEL, Jean-Marcel Erre a dit que ce roman était au départ une pièce de théâtre, mais qu’il n’avait pas trouvé d’éditeur pour la publier ni de metteur en scène pour la monter. Il l’a alors transformée en roman.
Avec des dialogues savoureux et beaucoup d’humour, cette satire sociale se lit d’une traite et fait du bien.
« Les emmerdements sont la force noire qui régit l’univers, et le petit récit qui va suivre se propose d’en être la plaisante illustration, histoire d’oublier un instant nos emmerdes en nous divertissant avec ceux des autres.
Au fond, les romans servent-ils à autre chose ? »
J.M. Erre écrit également des scénarios pour le cinéma et la BD. Sa première comédie sort ce mercredi sur grand écran : « Haut les mains ».
Je remercie Buchet Chastel pour cette lecture propice à la détente de mes zygomatiques que je vous recommande fortement.
Replay et podcast de la passionnante rencontre VLEEL à venir !
Incipit :
« Au commencement, il n’y avait rien.
Pas de temps, pas d’espace, pas de matière, pas de pensée, pas de mot, pas de pas. Même le néant n’existait pas, c’est dire. »
« Les époux Godart, Anna et Jean-Luc, sont nos personnages principaux. Ils peuvent avoir trente-trois, quarante-six ou soixante-neuf ans, qu’importe. Disons qu’ils ont votre âge, ça facilitera l’identification. Leurs caractéristiques physiques ? Visualisez des voisins, des collègues, des membres de votre famille, et vous tenez le couple Godart. Un conseil : prenez des gens que vous n’aimez pas. Comme il va leur tomber pas mal de trucs sur le coin de la figure, ce serait dommage de passer à côté du plaisir coupable délicieusement cathartique de voir des gens qu’on n’aime pas en baver, non ? Si. Assumons, assumons. »
« Vous avez demandé une intervention express d’Hervé Le Quellec, plombier impec. »
« Le Quellec jette un regard inquiet à JL qui le rassure :
– Anna est psychanalyste, elle aime traquer les lapsus.
– Ou les actes manqués, complète Anna. Comme acheter quinze pizzas pour deux. On sait que Freud relie les fonctions alimentaires et sexuelles, et la démesure des manifestations de l’oralité au refoulement sexuel.
– Je n’ai pas… tente JL.
– Ou comme faire venir un plombier pour « déboucher » quelque chose chez nous.
– Je n’ai…
– Ou comme porter un soutien-gorge ? tente Le Quellec.
– Exactement ! s’amuse Anna alors que JL se ferme. Il l’aimait bien son soutien-gorge, hein ?
– N’importe quoi… grommelle JL.
– Bon, c’est pas tout ça, fait Le Quellec en s’essuyant les mains sur sa salopette. Je vais vous faire la facture.
– Allez-y, dit Anna. C’est un autre point commun entre les psys et les plombiers, les tarifs prohibitifs.
– ça m’étonnerait qu’il arrive à te battre, rétorque JL.
– Jaloux. »
« Troisième sonnerie, puis des coups à la porte.
– Tu ne vas pas ouvrir ?
– Eh non.
– Rétention de la fuite freudienne ! s’exclame Le Quellec.
– Attitude de déni, refus d’affronter le réel, soupire Anna en s’engouffrant dans le couloir menant à la porte d’entrée. Mon pauvre Jean-Luc, tu files du mauvais coton. »
« – Excusez-moi, je suis fatiguée. Quelle était votre question ?
– Eh bien, j’ai remarqué votre tartine collée au plafond…
– Oui, je sais… soupire Anna.
– Je me demandais… Comment elle fait pour tenir ?
Anna lève les yeux vers la tartine et la fixe un long moment.
– Vous posez la seule vraie question, cher monsieur. Comment on fait tous pour tenir ? »