L’autrice a hérité du frigo de son grand-père. C’est le point de départ d’une succession de fragments sur la cuisine juive d’Europe de l’Est et plus particulièrement autour d’un plat mythique, le gefilte fish ou carpe farcie. Ce texte est à la fois ironique et profond. Élise Goldberg insère des questions et commentaires d’un « groupe Facebook des éplucheurs de boulbès », des apparitions de Columbo.
Il y a de nombreux mots en yiddish retranscris de manière personnelle. On découvre toute une culture, une identité ashkénaze.
Entre émotion, tendresse et humour, ce premier roman est une réflexion intime sur la famille et la transmission, où chaque plat raconte l’histoire familiale parsemée de souvenirs. Un régal !
Retrouvez de nombreux extraits ci-dessous pour en savourer toute la langue !
Incipit :
« Lorsqu’on brise un objet, si précieux soit-il, on sait déjà qu’on ne retrouvera pas l’intégralité des éclats, qu’on ne recollera pas tous les débris. »
« J’aime pourtant à penser que le frigo de mon grand-père – qui, vingt ans après, dans ma cuisine, remplit toujours son office – a apporté chez moi la mémoire de ces spécialités et ingrédients si singuliers que nous mangions chez lui les jours de fête. »
« Dans mon esprit d’enfant, le pain au pavot de la rue des Rosiers qu’apportait mon grand-père se confondait avec les petits grains noirs qui piquetaient ses paupières. »
« Un repas ashkénaze sans cornichons, c’est comme un gefilte fish sans sa gelée. C’est comme un sandwich de pain azyme sans garniture. […] C’est comme un Ashkénaze plein d’assurance, c’est comme un débat sans point Godwin, c’est comme un voyage sans encombre, comme un repas de (ma) famille sans blagues juives, c’est comme un escalier sans esprit, c’est comme un Ashkénaze sans mélancolie, c’est comme un Ashkénaze sans « et si… » (avec des si, on pourrait mettre Varsovie en bouteille), c’est comme un timbre de collection sans dentelure, c’est comme un Ashkénaze qui ne se plaindrait jamais, c’est comme une journée sans se cogner ou sans trébucher ou sans rien faire tomber, c’est comme un inconscient sans jeux de mots, c’est comme un Ashkénaze sans aquoibonisme. »
« Oui mais. Est-ce de cornichons qu’il est question ? Dans La Promesse de l’aube, Roman Gary évoque les concombres salés, écarte explicitement le terme cornichon. A Varsovie, le héros du Petit Monde de la rue Krochmalna, d’Isaac Bashevis Singer, sitôt installé dans le roman et à sa table, se voit servir un concombre au sel pour accompagner son hareng haché : pas un cornichon. Pourtant la vendeuse de Finkelsztajn, la boutique mythique de la rue des Rosiers, affirme que les concombres et cornichons, c’est fromage blanc et blanc fromage, le cornichon n’étant qu’un concombre cueilli petit. Sur Internet, je trouve tous les spécimens de réponses possibles. Le concombre ne serait-il qu’un cornichon qui aurait grandi ?
Fatiguée d’ergoter, j’ai décidé de couper le concombre en deux. Va pour le mot « cornichombre ». »
« Longtemps la cuisine ashkénaze m’a paru ringarde. Peut-être s’y intéresser est-il le signe qu’on l’est devenu soi-même. Ou qu’on a pris un coup de vieux – cet intérêt terreux pour les racines. »
« Conversation parentale. J’ai huit ans, et je ne sais comment, ma mère a découvert cette expression : l’esprit de l’escalier. Elle est frappée de constater à quel point sied à mon père cette disposition – ou plutôt cette non-disposition –, cette inaptitude à ajuster la réplique adéquate au bon moment. L’argument qui fait mouche apparaît à contretemps, quand le contradicteur est déjà loin. »
« On les a sur le bout de la langue, là où fourmillent les papilles. Les mots nous emplissent la bouche, sollicitent la mâchoire. Les mots sont des mets que l’on mastique. Nourriture que l’on concasse des molaires pour en faire des gru-mots. Mâcher ses mots. Simplement, ils sortent du corps plutôt que d’y entrer. La langue qu’on apprend, c’est comme la nourriture qu’on absorbe, il faut le temps de la métaboliser, de la digérer. La langue nous nourrit et chacune a sa saveur, yiddish compris. On dit le français plat pour son absence d’accent tonique, on le dit monocorde – fade ? Si l’on peut accuser sa cuisine de l’être, le yiddish, lui, est loin d’être insipide. Il a l’accent ironique. Et puis sentez toutes ces diphtongues dont il assaisonne allègrement sa base germanique, réveillant l’appétit. »
« Le yiddish, c’est le parler de l’autodérision, de l’antiphrase. Une langue qui se rit de l’ambition. Maxime yiddish quintessentielle entre toutes : L’homme fait des projets, Dieu rigole. »
« Maydalè, tishèlè, baymèlè, poupikèlè, pitsèlè, a stykèlè keyz kikhn… Petite fille, petite table, petit arbre, petit nombril, petit morceau (ou petit bébé, nourrisson), un petit bout de gâteau au fromage… En yiddish, chaque chose a son diminutif – toujours plus long que le mot qu’il est censé rapetisser. Même les petits riens ont leur version minusculisée : a bisl, un petit peu. A bisèlè, un tout petit peu. Ce peut être une marque d’affection, shayn maydalè. Tout devient mignon et sympathique. Mais tout devient aussi riquiqui, rien n’a d’envergure. En yiddish, difficile d’avoir la folie des grandeurs. Le mot « absolu » doit sans doute aussi avoir son diminutif. Tout est remis à sa place, bien au fond, dans l’obscurité, tassé dans le bocal de cornichons, en bas du frigo. »
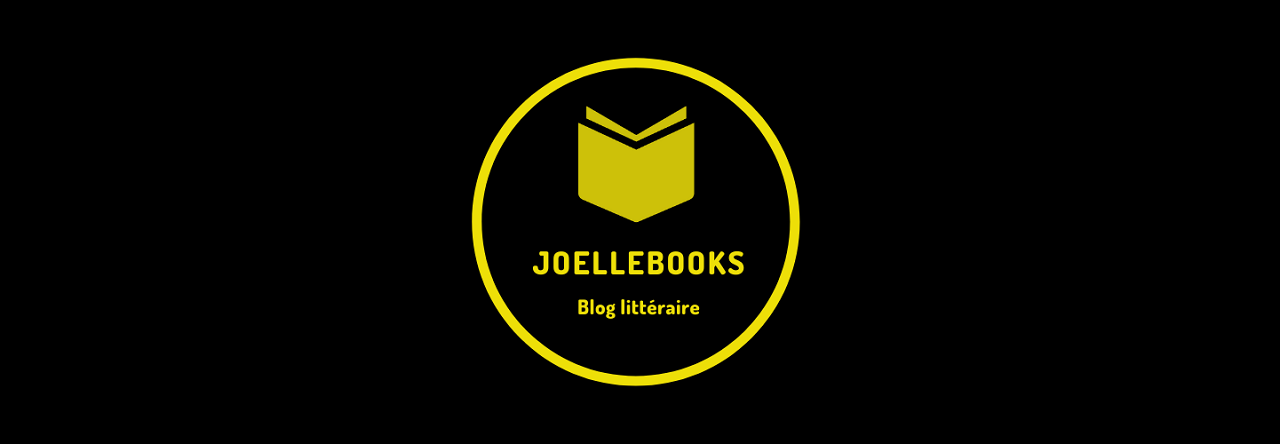
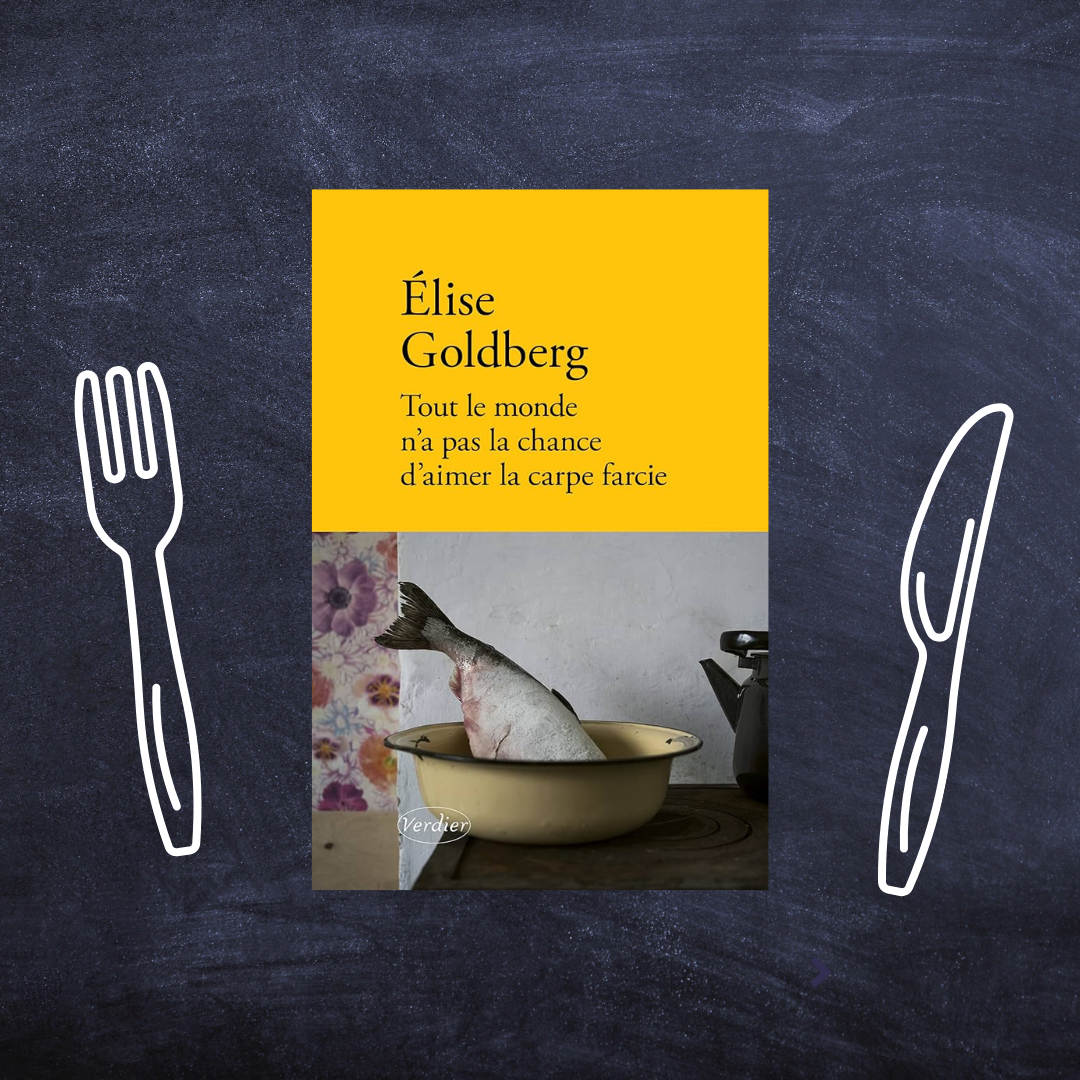
Un avis sur « Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie / Élise Goldberg »