Une vieille dame, Isadora, se retrouve en maison de retraite. Elle se remémore sa maison où elle a vécu toute sa vie et qu’elle a quittée avec regrets. Les souvenirs d’enfance affluent, saison après saison, avec la nature changeante. La Maison avec un M majuscule est un personnage à part entière. Une certaine nostalgie est présente tout au long du roman. J’ai ressenti aussi la solitude du personnage, la difficulté de vieillir et de ne plus pouvoir être autonome. Le livre se déroule dans une certaine lenteur, avec quelques questions en suspens notamment sur sa famille, dont le lecteur aura les réponses avant les dernières pages. Il y a un passage sur la lecture et la littérature qui plaira aux amateurs de livres.
Avec une très belle écriture, douce et poétique, Perrine Tripier fait appel à nos sens en décrivant la vie de cette femme. On se demande comment une si jeune autrice réussit à se projeter avec justesse dans le corps et les pensées d’une personne âgée. C’est là tout le pouvoir de la littérature.
Voici donc une jeune écrivaine prometteuse. Avec ce premier roman, elle fait partie des 5 finalistes du Prix Orange du livre 2023.
J’ai relevé de nombreux passages de toute beauté, à lire ci-dessous.
Incipit :
« Pluie fraîche sur pelouse bleue. Herbe d’été humide, relents de terre noire. Toujours ces averses d’août sur les tiges rases, brûlées d’or. Les lourdes gouttes ruissellent sur la vitre, sinuent, serpentent et s’entrelacent en longs rubans de lumière liquide. Combien d’après-midi passées derrière le voile vaporeux du rideau, à suivre du doigt leur tracé nerveux et languide à la fois. Les petits cheveux follets frisent autour des joues, et l’on s’étonne qu’ils soient si blancs alors qu’on est si jeune, nimbée d’éther sous la fenêtre. Et soudain le regard tombe de la fenêtre à la main qui écarte le rideau, et la main est vieille, si vieille. »
« Il est des lieux qui vous harponnent. Qui enroulent leurs mailles autour de vos songes, qui ajustent leurs griffes, juste assez pour vous laisser grandir, mais avec dans votre chair la meurtrissure de leur emprise.
Il est des portes dont le bruit quand on les pousse est comme un cri du temps qui brise encore l’oubli.
Il est des escaliers dont on aimerait tant gravir à nouveau les marches, juste une fois, en laissant couler dans sa paume le poli froid de la rampe.
ça, c’est la Maison. »
« J’ai assez aimé la Maison pour ne rien souhaiter d’autre, dans toute mon existence, que d’y demeurer, blottie au creux des choses familières, me laissant patiner par le temps exactement comme la rampe de l’escalier en colimaçon. »
« Je n’aimais rien tant que les étés, à la Maison. Tout rayonnait alors, dans la langueur moite des vacances, qui semblaient infinies, étirées par les longs jours d’ennui délicieux. Dès les premières chaleurs du mois de juin, tout se mettait à scintiller, à déborder de vie. Les érables et les sapins paraissaient gorgés d’une sève incandescente ; l’herbe, d’un vert insolent, était traversée de grands aplats de soleil.
Tout le monde revenait de la Ville, refluait vers la campagne familière et les forêts nimbées d’ombre lustrale. Il suffisait de se tenir à l’orée du bois pour sentir le vent embaumé de résine exhaler son murmure. Quand nous étions enfants, le frère et la sœur de mon père, oncle Bertie et tante Hilde, venaient chaque été avec leur famille. La joie quand on annonçait : « Les cousins arrivent ce soir ! » La journée s’imprégnait alors d’une agitation impatiente qui nous faisait sautiller en cercle dans le salon, et, grondés par Petit Père, nous remontions l’escalier en étouffant des rires nerveux. L’après-midi se passait en préparatifs affairés ; j’adorais seconder les parents, avec une attention minutieuse. Je veillais, tel un petit despote, à ce que le grenier soit aéré, les coffres à jouets ouverts, les draps pliés soigneusement sur les lits. Je dévalais l’escalier en colimaçon qu’on avait ciré pour l’occasion, je tourbillonnais dans le hall traversé par la lumière concassée du vitrail. Je venais vingt fois dans la cuisine, je me penchais sur le feu, je humais les fumets en soulevant, d’une main un peu tremblante, le couvercle des soupières. Je savais que la nourriture presque prête était le signal : les cousins seraient bientôt là, et nous serions tous, sous peu, attablés ensemble dans un brouhaha insupportable de rires sonores, relâchant la frénésie d’une longue journée d’attente. »
« Le vert vif de l’herbe, qui éclaboussait les pieds et chatouillait les yeux, donnait envie de s’y allonger, de se renverser pour contempler les cimes, pendant des heures. Il n’y a rien de tel pour se sentir vivre que de presser son dos contre la terre, et de laisser les tiges venues des entrailles du monde s’entremêler aux cheveux, nos doigts enfoncés dans la chair friable de l’écorce des choses. »
« La Maison était à moi, et j’étais à elle. J’avais, en prenant les clefs, imbibé les murs de mon ombre. Les étrangers familiers qui revenaient donc pénétraient dans mon cœur et rangeaient leurs valises ouvertes dans mes veines ; peut-être sans le savoir. »
« Il aurait voulu des enfants, sans doute, et moi je ne me suis jamais sentie mère, uniquement fille et sœur. Je fus une fille passable, peu tendre, mais une sœur exceptionnelle, je le crois. J’aimerais bien être encore sœur. »
« Toujours se méfier des amours d’hiver. C’est le corps qui réclame, par instinct de survie, un autre corps chaud contre lequel se blottir. À la fonte des neiges, tout réapparaît, dans sa vérité nue, dans sa primeur verte d’herbe jeune. »
« Petite Mère m’agaçait déjà, je me rappelle ; sa douceur m’irritait et m’apaisait à la fois, c’était un aiguillon et un baume. »
« Entrer en hospice m’a confrontée, violemment et implacablement, à ma disparition. Ce ne fut pas, en soi, une surprise ; on sait toute sa vie qu’il faudra mourir, et pourtant rien ne nous y prépare jamais, pas même la mort des autres. Quand le corps devient faible, on se retrouve soudain lesté par une accumulation de regrets si lourds, si pesants, qu’ils rendent la fin de vie profondément triste. La joie dans mon cœur a du mal à se soulever, du mal à prendre.
Quand j’étais encore à la Maison, il me semblait que l’abattement n’était pas complet. Je me sentais encore un peu utile, je vivais là où je m’étais épanouie, un jour ; je vivais dans l’illusion d’une continuité de ma personne. Je n’avais pas encore compris que ce qu’on accumule toute sa vie, les petites passions, les petites toquades, les goûts, la couleur préférée, les livres lus, les méthodes pour rempoter une plante, le secret pour une confiture réussie, tout cela disparaîtrait. Et avec moi, tout l’enseignement de Petite Mère, de Petit Père, tous les petits événements qui composèrent mon caractère, mon être aux autres. »

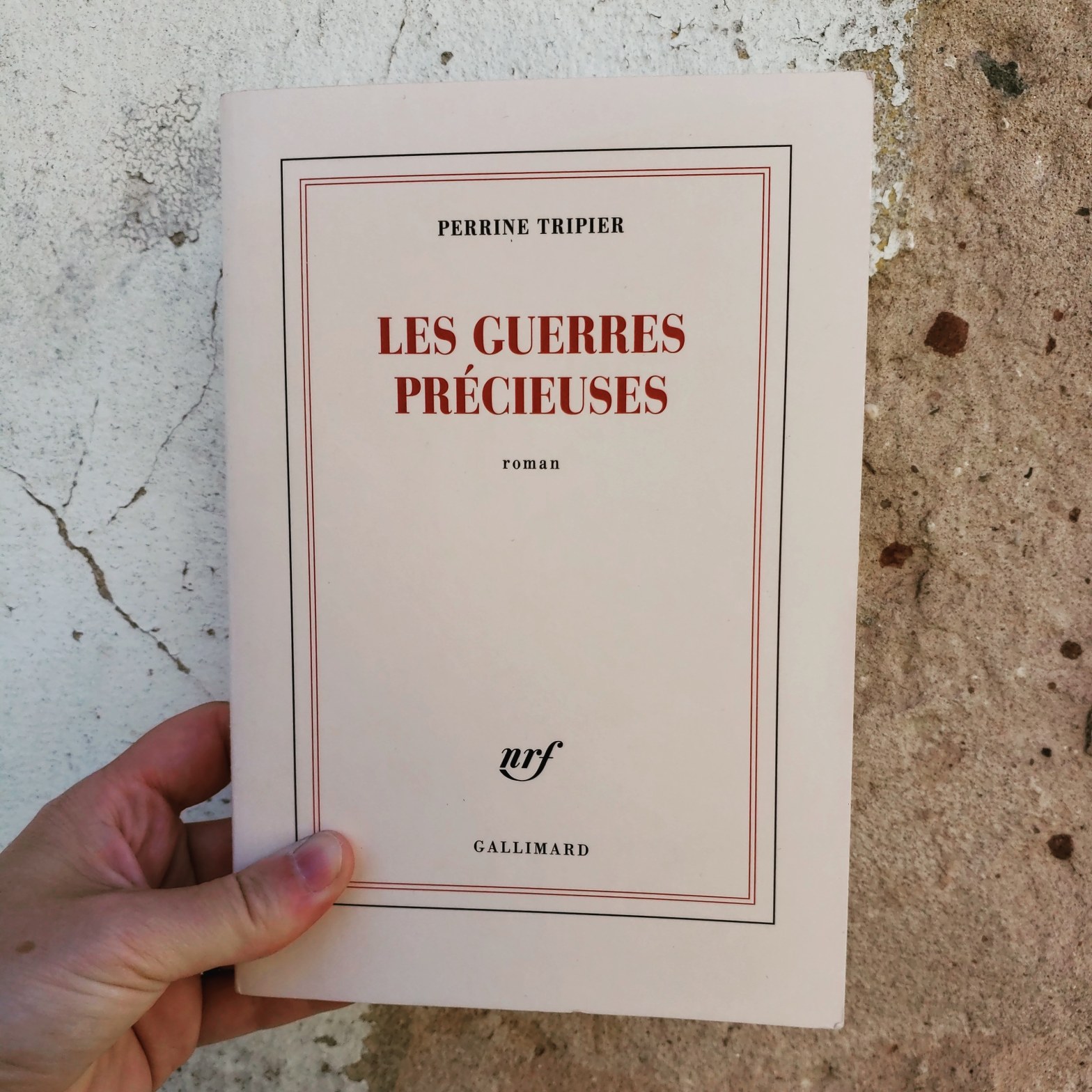
5 commentaires sur « Les guerres précieuses / Perrine Tripier »