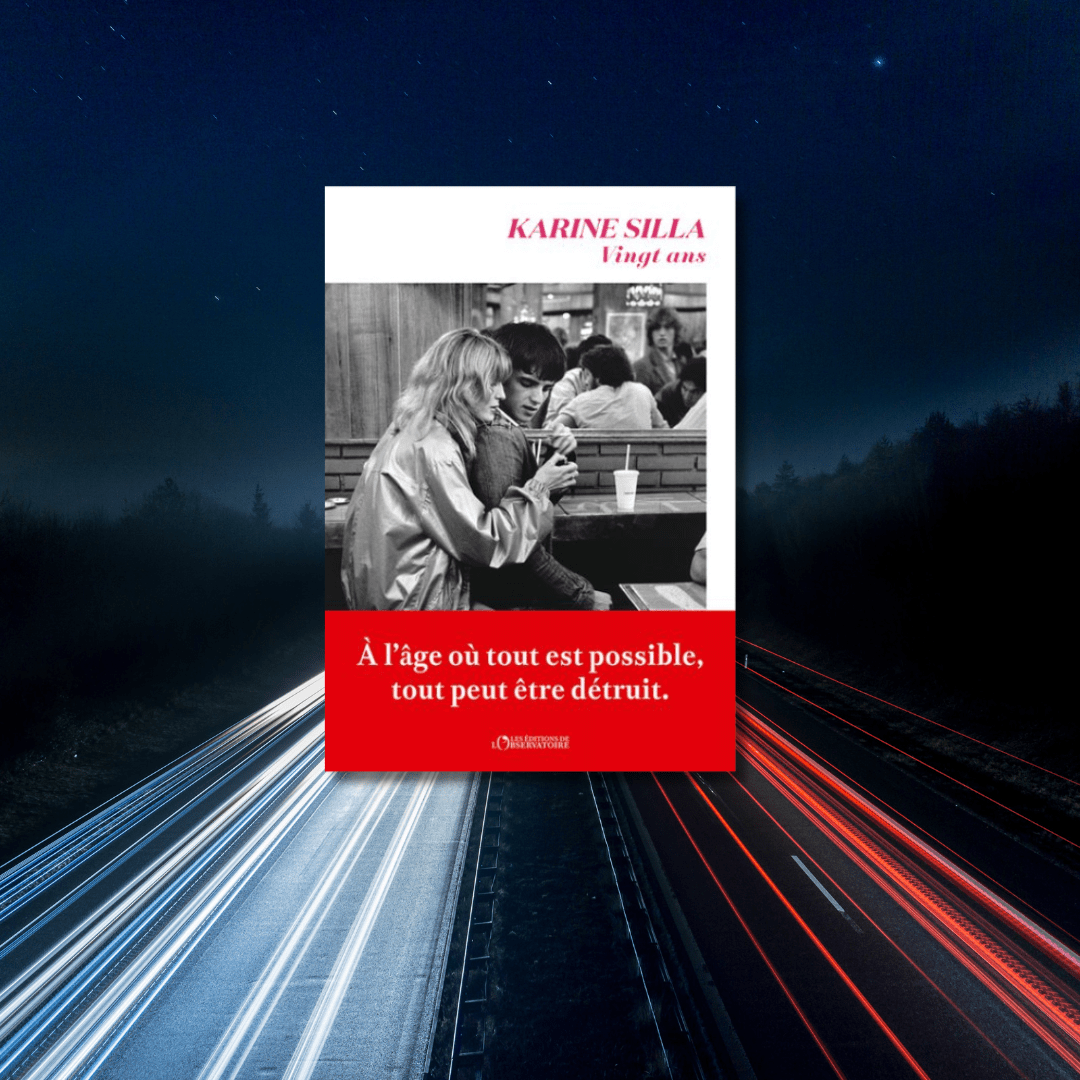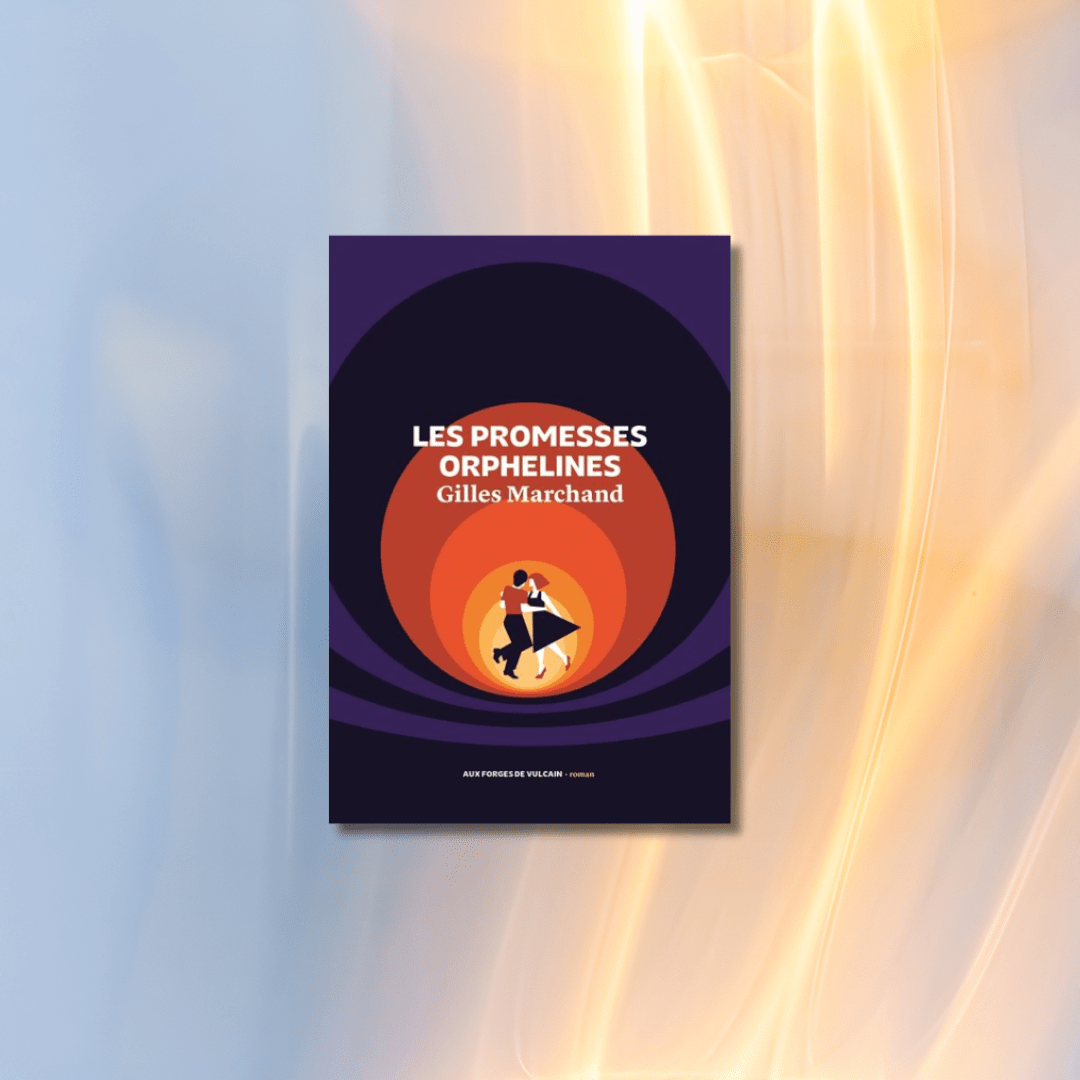1916, le sous-lieutenant Cointreau-whisky, alias Guillaume Apollinaire, engagé volontaire est touché par un éclat d’obus dans une tranchée.
L’auteur égrène les dernières heures d’Apollinaire au front. Chaque chapitre est un compte à rebours de l’obus qui éclatera. On observe la vie des poilus dans les tranchées. Il y a Trouillebleu, le Père Ubu, Dontacte, Jojo-la-Fanfare, les sobriquets des camarades de Cointreau-whisky. On ressent le froid, la faim, la peur. En première ligne de cette guerre, Apollinaire écrit des lettres, des poèmes, des textes pour une revue littéraire. La poésie est là, vitale. Il y a de très beaux passages sur l’écriture justement.
Cette lecture clôt le bookclub VLEEL d’octobre, autour de la maison d’édition Bruno Doucey, que j’aime beaucoup. Je découvre ce roman de 2016 que j’ai apprécié mais qui n’est pas un coup de cœur. Les citations, poèmes et calligrammes insérés entre les pages me donnent véritablement envie de lire et relire Apollinaire.
Le prochain bookclub VLEEL piochera un titre dans le catalogue des éditions Agullo. Encore de belles découvertes à venir avec les vleeleurs !
Incipit :
« Le 17 mars 1916, vers seize heures, le sous-lieutenant Gui de Kostrowitsky, dit Apollinaire, fut atteint à la temps par un éclat d’obus alors qu’il lisait une revue littéraire, le Mercure de France, dans une tranchée en première ligne, au lieu-dit le Bois des Buttes.
Cette revue, annotée de sa main, vient d’être retrouvée en Bavière, non loin de Munich. »
« La tombée de la nuit, c’est toujours un bon moment. Pour la poésie. Un moment qui fuit. Comme une gazelle.
D’une beauté simple, qui ne laisse personne insensible. Pas même le Père Ubu. Pas même le sergent Günter. Et puis ça passe. Et il fait noir.
Ce moment, Apollinaire s’exerce tous les soirs à en recueillir les parfums. Ce ne sont jamais les mêmes. Flaubert en a capturé quelques-uns. Avec justesse. Il les a enfermés dans un bocal, comme des papillons morts. Baudelaire les évoque. Sans jamais vraiment les saisir. Les laissant flotter dans l’air. Pissarro les fait frétiller sur la toile. Albert Samain les caresse. Saadi les a rendus éternels. Puisqu’ils sont périssables. Mais, ici, à la guerre, ils survivent à ceux qui les sentent. »
« Pour garder le pied ferme, il se raccroche aux mots comme à des cordes. Encore bien plus qu’auparavant. Il ne reste qu’eux de tangibles.
Lorsqu’il erre parmi les tranchées, s’adressant à l’un et à l’autre, c’est pour s’écouter parler. Pour vérifier qu’on l’entende. Compris ? Oui, chef. Lorsqu’il tape un gars sur l’épaule, c’est pour s’assurer qu’il est bien là devant lui. Lorsqu’il écrit à Madeleine, à Cocteau, à la rédaction d’un magazine, c’est pour s’expliquer avec lui-même. Se convaincre de sa propre présence. Le roulis ne cesse que lorsqu’il rédige et compose. Une phrase bien construite rétablit aussitôt l’équilibre. Une strophe réussie circonscrit le chaos. Le fait rimer avec la vie. C’est pour cela que Père Ubu raconte sa fable. Et que tous ici rigolent et bavardent.
Ceux qui se taisent sont déjà fous. Déjà morts. Si tu n’y prends garde, tu deviens vite une ombre chinoise.
Pour lui, les choses sont un peu différentes. Dontacte n’a pas amené ses dossiers, ses cachets, ses formulaires. Ni Trouillebleu sa pince à poinçonner. Leur métier n’a rien à voir avec la guerre. Rien à faire ici. Mais la poésie ça ne se range pas si facilement dans un tiroir.
Surtout que la guerre, c’est une aubaine pour les rimailleurs. Ceux de l’arrière, les patriotes, les grands lyriques, qui font rimer victoire avec abattoir. Soudain sacrés chantres de la République en armes. Et c’est un incroyable coup de veine pour ceux qui tonnent. Toute cette mise en scène. La fréquentation assidue de l’absurde, la mise à l’épreuve absolue de la vie et de la mort.
Péguy est passé par là. Et même Aragon. C’est au tour du grand Apollinaire d’entrer dans l’arène.
Paré de son costume de lumière. »
« [Impact moins 6 heures]
Vers dix heures, il rebrousse chemin, se disant qu’il a assez traîné. Qu’il lui faut regagner son poste. Qu’il est grand temps d’écrire un poème.
S’il a appris quelque chose, ici, c’est de ne rien remettre au lendemain.
Dans sa tête, un début de strophe danse la ronde. Les mots se tiennent la main puis la lâchent, sortant du cercle, y revenant, invitant d’autres à y entrer. Qui se tiennent timides, indécis, sur le côté. Les quadrilles se font, se défont, se reforment. Exécutant à chaque fois de nouvelles figures. Pas toujours en accord avec la musique. Ou est-ce la musique qui a du mal à les suivre ?
C’est le meilleur moment. Le plus beau. Ces fautes de pas, ces variations maladroites, ces demi-pointes. Quand le poète balbutie encore. Toute cette dérive.
La phrase flotte. Elle ondule, elle frétille. Elle se dandine. Se regarde dans la glace en faisant la coquette. Ou la fofolle. Elle voudrait tant être parfaite. Parfaitement belle. Elle se trémousse.
C’est quand elle bouge qu’elle est la plus vraie, la plus vivante. Il faut absolument la saisir à ce moment-là. En plein ébat. Pour qu’elle n’ait pas l’air d’une danseuse fatiguée. Quand on la couchera par écrit.
Si l’on tarde, les mots se bousculent, s’énervent. Deviennent indociles. Comme des bêtes qui sentent qu’on va leur passer le licol autour de l’échine. A trop vouloir fignoler, on risque soi-même de se disperser. De ne pas se souvenir des bonnes formules, mises de côté. Dont la première, instinctive, est souvent la meilleure.
Si l’on tergiverse trop, les lapsus, les barbarismes, les solécismes y mettent du leur. Et s’en donnent à cœur joie. Doit-on vraiment les éliminer ? Faire le ménage ? Il y a des impropriétés de langage qui touchent au sublime. Des perversions exquises. Un vrai régal. Eh quoi, toute poésie n’est-elle pas, en fin de compte, un majestueux acte manqué ?
Ah, c’est toute une affaire que d’écrire un poème ! Un immense agacement, un terrible plaisir.
Tu dois évoquer des images, oui. Mais tu n’es pas peintre. Faire résonner des musiques. Mais tu n’es pas chef d’orchestre. Ni même flûtiste. Conter une histoire sans en faire tout un roman. Bercer, faire rêver. Sans endormir, évidemment. Méditer sans réfléchir. Du moins pas vraiment. Donner des parfums à sentir. Et dieu sait quoi encore. Tout à la fois.
Et c’est là ta force.
De peintre-flutiste-conteur-métaphysicien-parfumeur-joaillier-batteur de tambour.
Qui n’en est pas un.
Les autres te diront qu’ils sont aussi poètes. Que tout le monde l’est un peu, à ses heures…
Et toi qui l’es tout le temps,
Au lit comme à la guerre,
Surtout à la guerre,
Tu les envies un peu. Et tu les plains.
De n’être poètes qu’à certaines heures. »
« Les gars du deuxième bataillon de poilus, au Bois des Buttes, sont légèrement en contrebas. Exposés. Presque à découvert. Ils le savent. Qu’il fasse clair ou brumeux ne change rien à l’affaire. C’est juste que les obus pètent mieux par temps sec. Quand il pleut à verse, ils s’enfoncent tête la première dans la gadoue. Et éclatent avec un peu moins de force. Ce n’est toutefois pas une raison pour préférer la pluie. Surtout qu’aujourd’hui, le vent est dans le bon sens. Il souffle en plein sur les boches. Trouillebleu estime que ça allonge la portée des lebel d’au moins cent mètres.
Le climat, c’est important. »
« Dès qu’Ubu quitte le boyau, un joli silence s’installe. Et la poésie revient.
Apollinaire met le courrier de côté. Il doit encore écrire à sa mère. Et à Reverdy. Mais il est fatigué et gai à la fois.
Il rêvasse. Songe à sa strophe. Et à la suivante. A composer. A poudre. L’accalmie, le temps radieux, sa bonne humeur, tout s’y prête. Une mélodie lui sourd du fond de l’âme. Encore souterraine. Phréatique. Qu’il laisse doucement poindre. Sans la brusquer. Ce n’est que lorsqu’elle débouchera au dehors, telle une source, qu’il s’y abreuvera. Et fera de son chant un ruissellement de paroles.
Cela demande de la retenue. Et un long entraînement. Que de savoir laisser un poème s’écrire de lui-même.
De ne pas forcer la muse.
Et ici, à la guerre, dans la tranchée que réchauffe le soleil, c’est bien plus facile d’y arriver.
Tu n’es pas au bistrot. Avec des alcools. Et une femme qui t’attend quelque part. Tu n’es pas au bord de la mer. Ou au sommet d’une montagne. La mer, la neige, tu ne les reverras peut-être pas.
Tu es parmi des hommes couverts de poux, enduits de suie. Qui ne liront pas ton poème. Pour qui ce que tu vas écrire n’aura aucune importance. Et à qui tes vers sont néanmoins dédiés. Aux poilus. Mais aussi aux frisés. Car tu ne demeureras poète que tant qu’ils ne t’auront pas tué.
Et toi, tu ne veux pas d’une gloire posthume. Pas de médailles. Pas de palmes d’académicien. Tu veux juste écrire un poème. Parce qu’il fait si beau, aujourd’hui. »